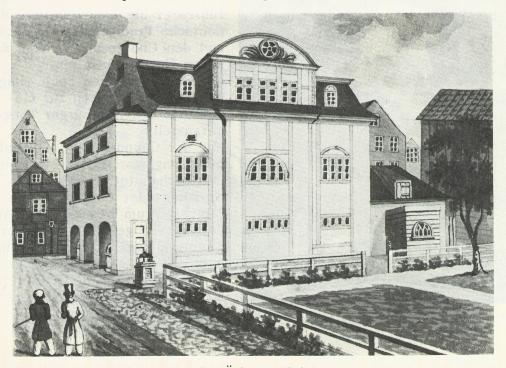Sur la Mémoire - Rabbin Professeur Jonathan Magonet - Yom Kippour 2013 - Montpellier
Partout où nous touchons le judaïsme, nous rencontrons une insistance sur la mémoire et le souvenir. Dans la Bible Hébraïque, le verbe zakhar, se souvenir, apparaît plus de deux cent fois. Mais zakhar est bien plus qu’un exercice intellectuel de mémoire. Il consiste à rendre quelque chose de vivant et de présent au monde. Lorsque la Bible nous demande de nous souvenir que nous étions esclaves en Égypte, nous devons faire nous-mêmes l’expérience de ce que signifie réellement l’esclavage que nous laissons derrière nous, et la libération que nous avons gagnée.
Notre tradition est prodigue en appels au souvenir. Nous nous souvenons et commémorons des évènements historiques, la plupart d’entre eux étant de nature tragique. Ils ont joué un grand rôle dans la constitution de notre identité juive. Cependant, se souvenir n’est pas simplement un rapport obsessionnel au passé. Se souvenir a un but, celui d’affecter et d’influencer nos actions présentes et futures.
De même que nous avons une obligation collective de se souvenir en tant que peuple juif, chacun d’entre nous a aussi la responsabilité de célébrer son propre passé. L’office de yizkor d’aujourd’hui nous offre la possibilité de penser à nos proches qui sont morts, de réfléchir à la signification de leur vie pour nous, une signification qui évolue d’année en année alors nous vieillissons.
Mais que se passerait-il si la mémoire faillit ? Dans son traité d’éthique hovot hal’vavot, les Devoirs du Cœur, le philosophe juif médiéval Bachya Ibn Pakouda (c.1050-1120) écrit à ce sujet. Ses mots sont particulièrement douloureux, maintenant que nous sommes mieux informés des effets de maladie telle que la maladie d’Alzheimer.
Quelle perte ce serait pour quelqu’un dans toutes ses affaires s’il était incapable de se souvenir de ce qu’il possède et de ce qu’il doit ; de ce qu’il a pris et de ce qu’il a donné ; de ce qu’il a vu et de ce qu’il a entendu ; de ce qu’il a dit et de ce qu’on lui a dit ; s’il ne peut se souvenir de celui qui l’a aidé et de celui qui lui a causé du tort ; de celui qui lui a rendu service, ou de celui qui l’a blessé. Une telle personne ne se souviendrait pas d’une route même s’il l’avait souvent empruntée, ni ne se souviendrait de quelque domaine du savoir, bien qu’il ait passé sa vie à l’étudier. L’expérience ne lui serait d’aucun bénéfice. Il ne pourrait estimer aucun cas par ce qui est arrivé dans le passé. Il ne pourrait pas plus envisager des évènements futurs à la lumière de ce qui se produit dans le présent. Une telle personne apparaîtrait presqu’entièrement sans les qualités qui font un être humain.
(Les Devoirs du Cœurs 2 :5, Hyamson 159-161).
Bachya Ibn Pakouda reconnaît aussi cependant qu’il est parfois important de ne pas se souvenir.
Oublier est aussi parfois utile. En effet, s’il n’était jamais possible d’oublier, une personne ne pourrait jamais échapper à la mélancolie. Aucune occasion joyeuse ne pourrait dissiper sa tristesse. Les évènements qui pourraient lui apporter de la satisfaction ne le rendraient jamais heureux lorsqu’il se souvient des difficultés de l’existence. Il ne pourrait même pas espérer tirer du repos et de la paix de la satisfaction de ses espoirs. Il ne pourrait jamais s’empêcher d’avoir du chagrin. Ainsi, voyez-vous, la capacité à se souvenir et la capacité à oublier, bien que différentes et contraires l’une à l’autre, sont des dons offerts à l’homme, chacune ayant son utilité.
(Hyamson, 161)
A quel point le souvenir est-il présent dans la vie juive d’aujourd’hui ? D’un certain côté, notre mémoire juive collective nous aide à définir notre identité en tant que peuple en maintenant ensemble des Juifs qui viennent d’horizons si variés. Aux côtés de ces mémoires ritualisées, il en est d’autres qui font partie de notre conscience personnelle des deux derniers siècles : les mondes de l’Europe orientale, ou d’Afrique du Nord que nos familles ont quitté pour venir s’installer dans l’Ouest. Notre connaissance de ces mondes nous vient de photos de famille, d’histoires qui ont été partiellement transmises, d’images populaires du passé. Ces souvenirs sont très forts, mais en même temps, ils sont colorés, voire distordus par les apports de notre éducation juive, ou des fragments de culture juive qui nous sont transmis par des documentaires télévisuels, ou des films hollywoodiens. Nous construisons pour nous-mêmes un passé commun largement fantasmé justement parce que nous avons hérité d’une fracture fondamentale dans la vie juive. Elle remonte à l’époque de l’Émancipation, avec son point culminant dans la Shoah.
Ce changement radical dans la mémoire juive a été exploré par l’historien Yosef Haim Yerushalmi dans son livre : Zakhor : Histoire Juive et Mémoire Juive. Dans cet ouvrage, Yosef Yerushalmi étudie la nature de la mémoire juive, ainsi que le rôle paradoxal de l’historien aujourd’hui. Il soutient que depuis l’Émancipation, il y a eu une fragmentation de la vie juive et une rupture dans la continuité avec le passé, ce que Yerushalmi appelle « une décomposition croissante de la mémoire collective juive » (p. 86). Par le passé, la mémoire juive était transmise de génération en génération dans le cadre de communautés fermées partageant les mêmes expériences. Avec la perte de ces communautés, ce type de mémoire a été perdu. En outre, un type différent de conscience historique détermine comment nous voyons le monde aujourd’hui. Yerushalmi suggère qu’à l’intérieur du monde juif, avec le développement de l’étude scientifique du judaïsme, l’histoire est devenue ce qu’elle n’a jamais été, ce qu’il appelle « la foi des Juifs déchus ». Voici ce qu’il écrit :
Pour la première fois dans l’histoire, ce n’est pas un texte sacré qui arbitre dans le judaïsme. Pratiquement toutes les idéologies du 19e siècle, depuis la Réforme jusqu’au sionisme, ont ressenti le besoin d’en appeler à l’histoire pour y trouver leur validité.
(Yerushalmi 86)
Yerushalmi décrit le dilemme de la façon suivante :
(L’historien) met au premier plan des textes, des évènements, des processus qui n’ont jamais réellement fait partie de la mémoire collective juive, même lorsqu’elle était la plus vigoureuse. Mais ce n’est pas tout. L’historien ne parvient pas seulement à reconstituer les lacunes de la mémoire. Il remet aussi constamment en cause ces mémoires qui nous sont parvenues intactes (Yerushalmi, 94).
Il conclue :
Au bout du compte, la mémoire juive ne peut être « guérie », à moins que le groupe lui-même n’obtienne guérison, à moins que sa complétude ne soit restaurée et régénérée. Mais pour les blessures infligées à la vie juive par les chocs désintégratifs des deux cent dernières années, l’historien est au mieux un pathologiste, à peine un médecin (Yerushalmi, 94).
Dans la situation que décrit Yerushalmi, nous vivons avec des fragments de ce qui était autrefois un tout, et nous créons en effet des identités juives alternatives qui dépendent des parties que nous choisissons. Ainsi, les différentes communautés religieuses, depuis les ultra-orthodoxes, jusqu’au libéraux, créent des identités cohérentes, qui se justifient elles-mêmes, et qui se placent au cœur de leur propre monde juif fantasmé.
Yerushalmi résume ainsi la nature de la société juive du passé :
Les mémoires collectives du peuple juif étaient une fonction de la foi partagée, de la cohésion et de la volonté du groupe lui-même, transmettant et recréant son passé à travers un réseau complet d’institutions sociales et religieuses en interaction, qui ont fonctionné de manière organique pour accomplir cet objectif (Yerushalmi, 94)
Gabriel Josipovici, écrivain et critique littéraire, oppose cette mémoire organique à ce qu’il appelle « la mémoire mythique », une mémoire créée et manipulée en vue de contrôler une population particulière. Il écrit :
Le 20e siècle a vu s’épanouir et disparaître beaucoup de ces mythes, le plus notable étant, bien évidemment, le mythe du Volk, du peuple en danger, nourri de manière si insidieuse par la machine de propagande nazie… Tout ce qui est nécessaire est la projection puissante d’une version simplifiée de l’histoire qui met en avant les maux causés à la communauté par les autres, et la nécessité de se battre pour nos droits dans un monde incompréhensible. Ce qui est particulièrement effrayant dans ce cas, est que rien ne semble capable d’écorner ces mythes puisque, comme en ce qui concerne la paranoïa, chaque nouvel événement est immédiatement réinterprété pour correspondre à ces mythes (Josipovici, 236).
Il soutient qu’il est nécessaire de « maîtriser la mémoire et le mythe, de ne pas masquer ce qui s’est passé, ni d’y retourner de manière compulsive » (Josipovici, 239).
Il se peut que les historiens ne puissent réparer une chaîne de mémoire brisée, cependant, insiste Yerushalmi, ils ont un rôle essentiel à jouer.
« La dignité essentielle de la vocation historique subsiste, et son impératif moral me semble maintenant plus urgent que jamais… Contre les agents de l’oubli, les destructeurs de documents, les assassins de la mémoire, les réviseurs d’encyclopédies, les conspirateurs du silence, contre ceux qui, selon la formidable image de l’écrivain tchèque Kundera peuvent effacer un homme d’une photo de façon à ce que seul son chapeau reste, seul l’historien, avec sa passion austère pour les faits, les témoignages, les preuves, si centrales à sa vocation, peut monter la garde de façon effective… (Yerushalmi, 116-117).
Le philosophe et écrivain Georges Steiner a identifié une tâche et une responsabilité identiques pour tous ceux qui sont, d’une manière ou d’une autre, des survivants.
Je crois que c’est la tâche et la responsabilité de ceux qui, par miracle ou par chance, ont survécu, de faire d’eux-mêmes ceux qui se souviennent contre le temps (Steiner, 13).
Mais est-ce seulement le devoir de l’historien ou du survivant ? N’est-ce pas, au fond, le devoir essentiel de nos traditions religieuses d’être « ceux qui se souviennent » ? Tel est, en tout cas, le message d’Abraham Joshua Heschel.
La mémoire est une source pour la foi. Avoir la foi, c’est se souvenir. La foi juive est la mémoire de tout ce qui est arrivé à Israël par le passé. Les évènements par lesquels l’esprit de Dieu est devenu une réalité se tiennent devant nos yeux, peints de couleurs qui ne s’estompent jamais. L’essentiel de ce que la Bible exige peut être résumé en un mot : souviens-toi… Les Juifs n’ont pas préservé les anciens monuments, ils ont conservé la mémoire des anciens moments» (Heschel, 162-163).
Mais la mémoire seule est-elle nécessaire ? Le Baal Shem Tov nous enseigne que « se souvenir est la première étape vers la rédemption ». Le souvenir, dans le judaïsme, ne consiste pas simplement à se rappeler du passé. Il s’agit plutôt de maintenir le passé dans une relation dynamique avec le présent, tout en s’orientant vers le futur.
Aujourd’hui, nous sommes pris entre deux responsabilités concurrentes : ne pas oublier le passé, mais en même temps, être clair sur la façon dont nous usons ce dont nous nous souvenons. La mémoire nous aide à apprendre les conséquences du passé sur nous, et comment il continue à agir sur nous aujourd’hui. Et grâce à cette connaissance critique de soi, nous disposons d’indications et d’avertissements, alors que cherchons à établir les prochaines étapes de notre parcours dans le judaïsme.
Il existe encore une autre dimension à ce processus de souvenir qui concerne bien plus un parcours intérieur. Plutôt que de considérer les interprétations historiques pour imaginer ce que le judaïsme a été, ou aurait pu être, l’approche alternative consiste à embrasser la totalité de ce que le monde a à offrir aujourd’hui, tout en l’utilisant pour nous frotter à notre judaïsme en le remettant en question.
Le philosophe Franz Rosenzweig est probablement celui qui est le plus associé à cette tentative de renouveler le judaïsme en y apportant tout ce que nous pouvons déduire de notre état d’aliénation. Dans une conférence donnée à l’occasion de l’ouverture de la Freies Jüdisches Lehrhaus à Francfort en 1920, il expliqua l’objectif de cette nouvelle aventure, objectif qui trouve un écho aujourd’hui dans des programmes tels que Limmud, des rencontres consacrées à l’étude dans lesquelles aucune tendance du judaïsme n’est exclue. Voici ce qu’il écrivit :
De nos jours, il n’y a pas une personne qui ne soit pas aliénée, ou qui ne contienne en elle une petite portion d’aliénation (ou, en d’autres termes, une certaine distance avec la tradition). Nous tous, pour qui le Judaïsme, pour qui être Juif est à nouveau devenu le pivot de nos vies… nous savons tous que nous ne devons rien abandonner, ni renoncer à quoi que ce soit, mais au contraire tout ramener au judaïsme. De la périphérie vers le centre, de l’extérieur vers l’intérieur… (Rosenzweig, 231)
Puissent les heures que vous passez ici deviennent des heures de mémoire, non dans le sens périmé d’une piété morte, qui est si souvent le cas en ce qui concerne des sujets juifs. Je pense à des heures d’un autre type de mémoire, une mémoire de l’intérieur, un retour de ce qui est extérieur vers ce qui se trouve à l’intérieur, un retour de ce qui, vous devez me croire deviendra, et devra devenir pour vous un retour à la maison » (Rosenzweig, 234).
Nous préservons la mémoire, mais nous sommes aussi les créateurs de mémoire. La société juive que nous formons et modelons aujourd’hui, ses valeurs, ses aspirations, la façon dont nous nous traitons les uns les autres, ce que nous offrons au monde extérieur, tout cela forme la mémoire que nous transmettons aux générations qui nous succèderont. C’est une grande responsabilité. Que voulons-nous que les générations futures retiennent de nos vies, de notre contribution au destin du peuple juif ?
Il est de notre devoir en tant qu’Israël de nous souvenir, mais notre tradition évoque aussi Dieu comme Celui qui se souvient particulièrement dans cette période où nous faisons pénitence. Dieu et Israël sont intimement liés par les liens de la mémoire, et cependant, de la mémoire vient l’espoir de renouveau. Ainsi ajoutons-nous dans la prière de la Amidah durant cette période une phrase qui lie la mémoire au futur, le souvenir qu’il y a une vie nouvelle devant nous, devant le peuple juif et le monde tout entier : zokhrenou l’hayyim, melekh hafetz ba’hayyim, v’kotveinou b’sefer ha-hayyim, l’ma’an’kha elohim hayyim. Souviens-toi de nous pour la vie, souverain qui se réjouit de la vie, et inscris-nous dans le Livre de la Vie en ta faveur, Dieu de la Vie.
Les effets de Diderot - Sermon de Yom Kippour - 2011 - Rabbin Professeur Jonathan Magonet
Il y a quelques années, nous avons vendu notre maison dans une banlieue de Londres. Les enfants avaient grandi et quitté la maison, et la maison était devenue trop grande. Nous avons trouvé un appartement près du centre de la ville. Il est un grand appartement, mais il est la moitié de la taille de notre ancienne maison. Nous avons vécu dans notre maison depuis vingt ans. Il avait un grand grenier. Un grand grenier est une tentation pour stocker des choses. Depuis vingt ans, nous avons donné à cette tentation. Soudain, dans quelques semaines, nous avons dû trouver un moyen de se débarrasser de presque toutes les choses que nous avions acquis et accumulés comme famille.
C'était un cauchemar. D'abord il y avait tous les souvenirs de famille liée à des objets particuliers. Boîtes contenant les dessins, cahiers, jouets des enfants de leurs journées d'école. Puis il y a eu deux séries de choses par rapport aux années universitaires de nos enfants. Cela comprenait des morceaux de vaisselle, des morceaux d'appareils électriques, vêtements, livres techniques, videos, etc. Nous les avons suppliés de le lui enlever. Nous avons essayé de les amener à décider quoi garder et quoi jeter. La date limite pour une telle décision allait et venait. Le grenier est restée pleine.
Mais pourquoi blâmer les enfants? Nous aussi, nous avions nos boîtes, valises, sacs à dos et sacs en plastique noir rempli de vêtements absolument essentielle - que nous n'avons jamais porté. En fin de compte ce que nous ne pouvions pas donner aux magasins de charité, nous avons dû jeter. Au début, il a été douloureux, mais à temps, il est devenu plus facile. D'une certaine manière nous avions pris une décision et se sont pris dans les pratiques.
Mais pourquoi est-il tellement là-haut dans le grenier? Pourquoi avons-nous d'accumuler tant de choses que nous n'avons pas besoin? Pourquoi, quand on remplace quelque chose, faisons-nous pas simplement le jeter, mais sentent le besoin de garder quelque part? Peut-être qu'il a quelque chose à voir avec l'identité. Nos biens nous rappeler notre passé, et dans une certaine mesure de qui nous sommes.
Une explication peut résider dans un essai par le philosophe Diderot, que sans doute vous connaissez et qui s’appelle ‘Regrets sur ma vielle robe de chambre’. Un ami lui a donné une belle robe de velours nouveau. Quelques jours après l'avoir porté il remarqua pour la première fois comment son étude a été minable, avec son vieux bureau et une lampe et des chaises. Alors, un par un, il se mit à les remplacer, d'abord le bureau, puis de la tapisserie, et finalement tous les meubles, jusqu'à ce qu'elle correspond à l'élégance de la robe. Mais plus tard, entouré par un mobilier moderne et lumineux, il commença à manquer la façon habituelle de l'étude - bondé, quelque peu chaotique, mais toujours agréable, méticuleusement ordonné, belle et sévère. Alors il a commencé à regretter l'abandon de la vieille robe et n'apprécient guère la nouvelle pour ayant forcer tout le reste de se conformer à son ton élégant.
Cette histoire a conduit un anthropologue de définir ce qu'il appelle parmi les consommateurs: les ‘effets de Diderot’. Il suppose qu'un certain nombre d'éléments, ensemble, forment une sorte d'unité stylistique qui montre votre position sociale. Un certain travail apporte avec elle les attentes d'un certain type de robe, maison, voiture etc. Donc, selon cette hypothèse, cet effet peut aussi devenir un outil pour encourager les gens à correspondre à tous leurs biens. Si quelque chose de nouveau est apporté qui fait des changements de la collection, puis nous avons mis sur le changement tout le reste pour correspondre à ce nouvel élément. Mais puisque nous avons encore un penchant pour les vieux, nous les conservons quelque part, juste au cas où nous en aurons besoin de nouveau.
Une grande partie de la structure financière de notre société dépend en encourageant les gens à acheter de nouvelles choses, à consommer plus et plus encore. Une fois un membre d’une synagogue à Londres m’a expliqué comment cela fonctionne. Il était un vendeur professionnel, et il m'a parlé au sujet de certains conseils qu'il a été donné quand il a commencé le travail. Son patron l'a appelé après quelques semaines et lui a expliqué qu'il ne serait jamais réussi parce qu'il avait obtenu ses priorités mal. Votre travail, dit-il, n'est pas de vendre à la ménagère anglaise ce qu'elle a besoin, votre travail est de vendre à la ménagère anglaise ce que la ménagère américaine désires!
Nous vivons dans un monde qui se met à créer en nous des désirs et qui fait tout le nécessaire afin que nous aller acheter quoi que ce soit. Une approche consiste à créer des produits à la désuétude. Au lieu d'être préparé de le réparer, nous avons besoin de le remplacer. Mais certaines choses vont endurer. Donc, puisque l'on ne peut le vendre à nous q’une fois seule, quelque chose doit être fait pour rendre celle que nous avons semble moins souhaitable, une sorte de désuétude psychologique, car alors nous voulons acheter plus tard, le modèle le plus récent.
Il n'est pas facile d'échapper à cette pression sans fin pour les nouveaux, parce qu'il est lié à notre image de soi et, souvent, notre envie des autres. J'ai appris cela il y a plusieurs années à Jérusalem. J'étais là en 1967 pendant la guerre de six jours. Quelques jours après, les deux populations, Juif et Arabe, se mêlaient et pourrait se voir pour la première fois depuis des décennies. Ma logeuse à l'époque, Giveret Shatner, a été l'un des membres fondateur de l'un des kibboutzim. Un jour elle m'a raconté une histoire sur quelque chose qui lui avait fait très en colère. Une touriste américaine avait parlé d’avoir vue des enfants arabes de la Vieille Ville errant autour de Jérusalem-Ouest. Elle disait comment ils étaient pauvres, et ma logeuse l’a reprimandée. Ces enfants, dit-elle, avait de la nourriture, des vêtements et ont été très bien soigné. Mais si vous voulez voir la vraie pauvreté, à Jérusalem venir avec moi! Elle l'a emmenée à Rehavia, le plus riche banlieue de Jérusalem, et entra dans une des rues. Elle a souligné l'une des maisons et dit: Tu vois l'homme qui vit là-bas? Il est très bouleversé parce que son voisin vient d'acheter une nouvelle voiture qui est meilleure que la sienne. Vous voulez savoir la pauvreté réelle? Celui-ci c'est la pauvreté!
Qu'elle le sache ou non elle cite les mots de Ben Zoma du Pirqe Avot, (4:1) eizehu achir - ha-sameach b'chelko, «qui est riche? Ceux qui sont heureux avec ce qu'ils ont.
Maïmonide avait déjà anticipé Diderot. Il a formulé le problème:
L'âme quand habitués à des choses superflues acquiert une habitude fort de désirer d'autres qui sont nécessaires ni pour la conservation de l'individu, ni pour celle de l'espèce. Ce désir est sans limite, les choses qui sont nécessaires alors que sont peu nombreux et limités. Met ce bien à coeur, y réfléchir encore et encore; ce qui est superflu est sans fin (et donc le désir pour elle est également sans limite). Ainsi, vous avez le désir de vos vaisseaux d'argent, mais vaisseaux d'or sont encore mieux, d'autres ont même acheté de vaisseaux saphirs, émeraudes, ou rubis. Ceux donc qui sont ignorants de cette vérité, que le désir pour des choses superflues est sans limite, sont constamment en difficulté et la douleur. Quand ils répondent ainsi aux conséquences de leurs cours, ils se plaignent du jugement de Dieu. Ils vont même jusqu'à dire que la puissance de Dieu est insuffisant, parce qu'il a donné à cet univers les propriétés dont ils imaginer la cause de ces maux.
Peut-être Maïmonide est trop ascétiques à notre goût et de ses attentes trop grandes. Nachman de Bratslav, le grand maître hassidique, a formulé d'une manière différente. Il parle en termes de ‘yetzer hara’, mauvais penchant, cette conception rabbinique de la conduire en êtres humains qui mène à des actes répréhensibles.
‘Le mauvais penchant est comme celui qui fonctionne dans le monde gardant sa main fermée. Personne ne sait ce qu'il a à l'intérieur de celui-ci. Il monte à tout le monde et demande: ‘Que pensez-vous que j'ai dans ma main ?’ Et chaque personne pense que tout ce qu'il veut le plus y est cachée?. Et tout le monde court après le mauvais penchant. Puis il ouvre sa main et elle est vide.’
Mais les rabbins étaient conscients de l'importance du mauvais penchant. Un jour, ils ont réussi à le capturer et le mettre dans une bouteille. Mais le lendemain ils ont remarqué que les poules ne pondent, et que le monde est venu à un arrêt. Sans l'énergie et l'ambition du mauvais penchant rien ne serait créé. L'histoire nous rappelle que nous devons trouver un équilibre entre nos désirs de plus en plus, et la nécessité de fixer des limites ; de contrôler nos actions parce qu’ils n'affectent pas seulement nous, mais ceux qui nous entourent, et finalement le monde entier.
Aujourd'hui, nous sommes au milieu d'une crise financière mondiale qui peuvent changer radicalement les choses que nous tenons pour acquis. Dans certaines parties du monde cela devient une question de vie ou de mort. Pour nous, il ne peut être q’une question d'une réduction de notre niveau de vie, mais le sentiment de perte, de choc, de peur peut être écrasante. C'est acceptable de renoncer quelque chose parce que nous avons choisi de le faire. Il est assez différente de sentir qu'elle a été prise de nous, de se sentir impuissant dans le pouvoir des forces qui nous dépasse.
A cette époque de l'année, nous sommes censés faire un ‘cheshbon ha-nefech’, un compte rendu de nos vies. Nous pouvons voir cela en termes purement spirituels. Comment pouvons-nous nous comporter? Comment nous comportons-nous les uns aux autres? Comment traitons-nous notre famille et nos amis? Est-ce que nous avons blessé quelqu'un dans le cours de la dernière année? Comment peut-on réparer les dégâts?
Mais peut-être cela a une autre dimension pratique ainsi. Que se passerait-il si nous prenions au sérieux les mots Maïmonide : ‘Ce qui est superflu est sans fin (et donc le désir pour elle est également sans limite’. Que faire si une fois par an nous avons fait un inventaire de toutes les choses que nous avons, mais n'ont pas vraiment besoin ou utiliser? Pourrions-nous nous simplifier la vie? Pourrions-nous même contribuer aux préoccupations environnementales en consommant moins et en créant moins de déchets? Peut-être la seule manière dont nous pouvons posséder quelque chose, c'est quand nous sommes prêts et capables de le renoncer. Ce que nous sentons que nous ne pouvons pas renoncer de suite, possède vraiment nous.
Yom Kippour est un temps pour nettoyer les choses de la dernière année dont nous savons que nous n'avons pas besoin. Tous les rancunes, les souvenirs malheureux, les échecs, les péchés, les actes égoïstes, les moments embarrassants de découverte de soi, culpabilité, colères vieilles avec quelqu'un qui ressemblent assez stupides aujourd'hui, rétrospectivement. Mais aussi la cupidité et l'envie. Nous vider les poubelles afin que nous puissions voir plus clairement ce qui compte vraiment, ce que nous voulons garder ce que nous avons besoin pour l'avenir. Nous savons que nous ne serons pas libres de la même volonté de rassembler, mais peut-être nous allons examiner de plus et de garder moins.
Puissions-nous profiter de notre nouvelle robe de chambre, mais ne pas être emprisonné par elle. Puisse la nouvelle année nous apporter un nouvel moyen de vivre et d’espoir.
"De Lilith, sujet à Eve, objet : du féminin dans la tradition juive ou le complexe de la pomme", par Brigitte Frois
Plaque Burney, British Museum, appelée aussi la Reine de la Nuit (1792-1750 BCE), parfois identifiée à Lilith
Introduction
Juive d’origine sépharade, née en Tunisie, d’une famille traditionnaliste implantée depuis des centaines d’années en Afrique du Nord, j’ai renoué avec ma tradition grâce à ma rencontre avec la communauté libérale à laquelle j’appartiens depuis 20 ans.
Le qualificatif libéral est une traduction approximative du mot anglais « progressive », ce mouvement étant né dans le monde anglo-saxon au XIXème siècle : le judaïsme libéral n’est pas un judaïsme qui s’est permis de prendre des « libertés » avec la tradition mais qui au contraire s’est inscrit dans cette tradition en la réinterprétant afin qu’elle puisse continuer à vivre en faisant sens aujourd’hui.
La parfaite égalité entre hommes et femmes qui est la règle dans les communautés libérales m’ a permis d’assurer des fonctions d’administratrice pendant plus de 6 ans puis de présidente de Keren Or de 2013 à 2016.
Cette réconciliation avec mes origines n’aurait jamais été possible sans cette rencontre avec le mouvement libéral : je n’aurais pas fréquenté une synagogue dans laquelle mon statut de femme m’aurait reléguée à l’écart de la liturgie et de la lecture de la Torah derrière la méhitsa, cette cloison qui sépare les hommes et les femmes.
Nombre de femmes juives et aussi d’hommes juifs partagent cette position qui refusent de prendre congé de leur femme, de leur mère, de leur sœur ou de leur fille quand ils franchissent les portes de la synagogue.
C’est pourquoi rejoindre le mouvement libéral a été pour moi une évidence.
Cependant les différences d’interprétation des textes qui traitent du statut de la femme entre certains courants du judaïsme orthodoxe, le judaïsme conservateur (ou massorti) et le judaïsme libéral sont majeures et suscitent de nombreuses interrogations.
Comme l ‘écrit le rabbin Pauline Bèbe, première femme ordonnée rabbin en France au sein de la communauté juive libérale de Paris, dans un livre qui fait référence « Isha, dictionnaire des femmes et du judaïsme » : « le Dieu de l’humanité n’ a pu dicter la domination d’une moitié de l’humanité sur l’autre. Les nouvelles idées apportées sur les femmes par le monde moderne doivent être intégrées à notre tradition afin que les femmes puissent faire leur le judaïsme, l’écrire autant que l’interpréter, l’enseigner et le transmettre ».
Alors comment interpréter les textes de la Torah (constituée des 5 livres : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome) et les commentaires des rabbins compilés dans une partie du Talmud qu’on appelle la halakha (loi juive) quant au statut de la femme ?
Notamment les textes qui relatent dans Berechit (Genèse) l’apparition de la femme avec les 2 récits de création, ceux qui traitent des lois de nidda qui régissent la vie sexuelle du couple, ceux qui régissent le divorce religieux ainsi que ceux concernant la place des femmes dans la liturgie et l’étude de la Torah ?
Je tenterai de donner quelques piste de réflexion pour amorcer des réponses à ces questions auxquelles je n’ai pas la prétention de répondre, je souhaite seulement mettre en évidence à quel point une relecture de ces textes nous donne à penser et ouvre de nouvelles perspectives.
Je m’appuierai pour ce faire sur les travaux de différents rabbins et commentateurs de toutes périodes et de toutes tendances ainsi que sur des écrits d’historiens, de sociologues et psychanalystes.
Quand les dieux étaient des déesses
Le texte de la Torah est encore loin d’avoir livré tous ses secrets mais il est certain que sa rédaction s’est faite sur plusieurs siècles et qu’il est imprégné du contexte historique et culturel des différentes époques traversées. L’influence en particulier des cultures égyptiennes, mésopotamiennes et grecques sur nombre de textes de la Torah est maintenant prouvée .
L’arbre et le serpent qu’on trouve dans la Genèse étaient des symboles de la sagesse et de la puissance oraculaire de la Pythie à Delphes, le récit du Cantique des Cantiques est très proche d’un récit de la mythologie égyptienne (d’ailleurs dans le livre des Rois, 11 ;5 il est rappelé que Salomon avait une dévotion pour la déesse Astarté),il existe des similitudes évidentes entre le récit du Déluge et l’épopée de Gilgamesh découverte sur une tablette du IIIème millénaire avant notre ère à Nippur en Irak, il y a une analogie entre l’enfance de Moïse et la légende de la naissance merveilleuse du roi sumérien Sargon qui aurait vécu entre 2385 et 2279 avant notre ère ainsi qu’entre un épisode de la vie de Joseph en Egypte et le conte des deux frères issus de la littérature égyptienne du nouvel Empire (XIIIème siècle avant notre ère).
Or comme le montrent les travaux de l’historien Djénane Kareh Tiger dans ce monde polythéiste du Proche-Orient les dieux étaient des déesses : les innombrables statues féminines retrouvées au Proche-Orient jusqu’en Anatolie à partir du IXème siècle avant notre ère en témoignent.
Veillant sur la fécondité des champs, des hommes et des troupeaux elles sont les probables héritières de Vénus rudimentaires, vieilles pour certaines d’une trentaine de milliers d’années, découvertes en Europe et en Sibérie. Elles font l’objet d’un véritable culte , prélude aux rituels des premières religions établies qui naissent avant notre ère, d’abord en Mésopotamie puis en Egypte et dans le reste du monde. Au fur et à mesure de l’évolution de la société et de l’apparition des technologies agraires qui engendrent les premiers surplus, le commerce se développe, les classes sociales se forment, des hiérarchies s’instaurent. Les hommes gèrent la vie extérieure, les femmes s’occupent de la maisonnée. Le patriarcat se consolide. Il devient de plus en plus difficile aux mâles qui régentent la vie de la société de s’accommoder de divinités qui ne soient pas à leur image, virile et protectrice. Ainsi Vénus rentre à la maison pour s’installer au cœur des cultes domestiques.
En Egypte nés à partir du Noum, l’océan primordial, des dieux crées, ni immortels ni omnipotents veillent sur les humains et chacun choisit son Dieu : il ne s’agit pas d’un authentique monothéisme mais d’une monolâtrie :un seul Dieu considéré comme le plus grand est vénéré.
A une exception près, celle de la parenthèse monothéiste imposée par le pharaon Aménophis IV, Akhénaton, au XIVème siècle avant notre ère pour qui Aton est le dieu unique qui ne tolère aucun autre Dieu et dont le pharaon est le prophète. Ce modèle de monothéisme exclusif est celui de Moïse, un monothéisme qui contrairement à la monolâtrie ne tolère aucune autre divinité et encore moins une divinité féminine.
Avec l’avènement du monothéisme disparaissent les déesses et la participation des femmes israélites au culte et à l’étude sera désormais strictement régentée par la loi de la Torah ou halakha.
Les femmes sont cantonnées aux fonctions domestiques et en terme d’obligations religieuses leur statut est proche de celui des esclaves et des enfants : elles sont inaptes à témoigner, exclues de l’étude de la Torah et du culte.
Cependant compte-tenu de la condition des femmes à cette époque ce constat est à nuancer : la loi biblique permettait aux femmes israélites de vivre mieux que les femmes des cultures voisines. En effet ses droits étaient protégés : elles ne pouvaient être mariées sans leur consentement, la ketoubah (contrat de mariage) était un document légal qui la protégeait et lui garantissait une assurance financière en cas de divorce.
On voit donc que si la tradition juive a été en avance sur son temps concernant certains points elle n’en a pas moins relégué la femme dans l’espace domestique où son rôle est magnifié par les rabbins tant qu’elle reste bien sûr dans les fonctions qui lui sont imparties. Cette attitude ambivalente de certains rabbins envers la femme oscillant entre l’estime et le maintien de préjugés sexistes plus ou moins affichés est symptomatique de la difficulté qu’ils rencontrent à réinterroger profondément la halakha quand celle-ci traite du statut de la femme.
Le Dieu de la Torah est-il misogyne ?
Dès lors doit-on penser que le Dieu de la Torah a voulu ce statut d’infériorité des femmes ? Le Dieu de la Torah serait-il misogyne ?
Des années entières d’études de la Torah ne suffiraient pas à répondre à cette question. Cependant si nous regardons de près certains passages bibliques et les commentaires qu’ils ont suscités nous verrons que nous sommes en droit de remettre en cause très sérieusement le fondement halakhique du sort réservé aux femmes au sein des mouvements du judaïsme qui se disent les plus fidèles à la tradition, les mouvements dits orthodoxes et ultra-orthodoxes
Quant aux deux autres principaux courants du judaïsme : le judaïsme libéral et le judaïsme massorti , tous deux issus de la haskala, le mouvement juif des lumières qui a débuté en Allemagne à la fin du XVIIIième siècle, ils accordent dès le début du XXième siècle une totale égalité aux femmes dans tous les domaines de la vie religieuse.
Ces deux mouvements sont largement majoritaires dans le monde : 1,7 millions de membres pour le judaïsme libéral appartenant à 1200 communautés à travers le monde mais en France c’est le judaïsme orthodoxe qui rassemble le plus de fidèles.
Pourquoi cette différence majeure quant au statut des femmes entre mouvances orthodoxes et les autres ?
L’explication tient au fait que les penseurs de la réforme juive issus de la haskalah ont senti la nécessité d’adapter la tradition à l’environnement de la modernité considérant que chaque génération est mise en demeure de rédécouvrir la validité présente de la halakha. C’est pourquoi ils ont mis au point un ensemble de critères pour juger de l’opportunité de telle ou telle mitsvah (commandement religieux) :
1) sa finalité et son développement historique
2) sa capacité à sanctifier la vie
3) le fait que les conditions actuelles permettent son accomplissement
4) les conséquences sur le peuple juif dans son ensemble
5) le fait qu’elle n’entre pas en conflit avec la voix de la conscience
Bien que les courants orthodoxes n’aient pas réellement remis en question le fondement des mitsvot (commandements religieux) concernant les femmes , des voix féminines mais aussi masculines s’élèvent à l’intérieur même de ces mouvements pour réclamer une relecture des textes non pas pour leur faire dire ce qu’ils ne contiennent pas mais pour les scruter d’un regard neuf dans le siècle qui est le nôtre selon le principe que chaque génération doit redécouvrir la validité présente de la halakha.
La Torah dont la racine vient du mot enseigner n’est ni un livre d’histoire ni un livre de géographie ;elle n’ a pas pour fonction de nous raconter ce qui s’est exactement passé ni de service de cadastre . La Torah est composée de récits oraux qui ont été mis par écrit et commentées dans le Talmud, la halakha constitue la partie du Talmud qui contient l’ensemble de la loi juive. Elle traite des obligations religieuses auxquelles doivent se soumettre les juifs, aussi bien dans leurs relations avec leurs proches que dans leur rapport à Dieu et elle englobe tous les aspects de l’existence : la naissance, le mariage, les joies et les peines, l’agriculture et le commerce, l’éthique et la théologie.
Le mot halakha est dérivé de la racine hakakh qui signifie marcher : c’est une loi en mouvement. Son contenu ne saurait être immuable. Comme il est écrit dans un texte du talmud, le traité Sanhédrin 34 a : « De même que la roche est divisée par le marteau en une multitude de fragments, un seul texte biblique donne lieu à de multiples interprétations ».
La langue hébraïque de par sa structure même se prête parfaitement à cette interprétation plurielle puisque les mots y sont constitués à partir de racines trilitères et que l’ajout de voyelles ou de suffixes ou préfixes en modifie le sens .
Comme l’écrit le rabbin Delphine Horvilleur dans son livre « En Tenue d’Eve », la page du Talmud est l’illustration de ne pas tomber d’accord, cette expression française évoquant la conciliation comme une chute.
On voit donc à quel point se contenter d’un seul niveau littéral d’interprétation des textes c’est trahir la tradition.
Tous les textes halakhiques sont étudiés et commentés depuis des siècles par les décisionnaires au sein du judaïsme :compte-tenu du développement des sciences et des techniques inimaginables il y a quelques générations en arrière, des problèmes sans précédent se posent pour lesquels aucune réponse ne figure dans la halakha traditionnelle.
Comment imaginer que les questionnements se cantonnent aux domaines des sciences et de la technologie sans prendre en compte les évolutions sociétales ? .Pour les juifs qui s’interrogent chaque époque a besoin d’une nouvelle interprétation et de nouvelles modalités d’application des lois reçues en héritage.
Prenons par exemple les deux récits de création de la femme qui figurent dans la Genèse ainsi que la description du jardin d’Eden et de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
Voici le texte du premier récit chapitre 1 verset 26 : « Et Dieu créa l’homme à son image, à son image il le créa : mâle et femelle il les créa ».
Et voici le texte du second récit chapitre 2 verset 21 : « L’Éternel Dieu fit alors tomber un profond sommeil sur l’homme et il dormit :il prit un de ses côtés( ou une de ses côte selon la traduction choisie ) et combla de chair sa place . L’Éternel Dieu façonna le côté qu’il avait pris à l’homme en femme et il l’amena à l’homme. Et l’homme dit : cette fois-ci c’est un os de mes os et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Icha car c’est de Ich que celle-ci a été prise. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair ».
Le rabbin Pauline Bebe dans son livre « Isha, dictionnaire des femmes et du judaïsme » fait de ces deux textes un commentaire très détaillé :
Ces deux récits de création sont attribués à des sources différentes, ils présentent la femme de manière opposée Le premier récit est égalitaire : la femme y est créée en même temps que l’homme sous le nom générique de adam, être humain, aucune hiérarchie n’est présente. L’humanité apparait sous deux formes : féminine et masculine. Cette humanité dans sa complémentarité est un reflet de la divinité.
Une interprétation du Talmud dans Genèse Rabba (8-1) est que le premier être humain était androgyne, réunissant ces deux principes masculin et féminin qui furent séparés et cherchent à se retrouver. Ce qui évoque le mythe platonicien de l’origine des sexes :un premier être androgyne séparé en deux moitiés à l’origine des deux genres, ces deux êtres restant nostalgiques de l’unité perdue et recherchant sans cesse l’autre moitié.
Le second récit plus ancien, présente la création de la femme comme un remède à la solitude de l’homme.
Par ailleurs le choix de la traduction du mot hébreu tsela en côte ou côté est important. Dans la bible le mot tsela est toujours traduit par côté et non par côte.
Comme le souligne le rabbin Delphine Horvilleur dans son livre « En tenue d’Eve », cette différence de traduction a de lourdes répercussions : dans un cas la femme côte est un bout du corps d’Adam, restant par son origine dépendante du corps premier masculin. Dans l’autre cas la femme côté est une césure d’un être originel androgyne dorénavant coupé en deux. Elle est donc un autre sujet et non un objet, sorti de l’organisme premier à deux genres au même titre que l’homme.
Comment les exégètes réconcilient –t’ils ces deux versions de la création de la femme ?
En effet pour les commentateurs traditionnels le texte sacré étant d’origine révélé il doit être pensé dans sa cohérence peu importe que ces deux textes aient été écrits à des époques différentes ils ne doivent pas se contredire.
Deux légendes juives permettent de concilier ces versets contradictoires :
La première est la légende de Lilith, la deuxième est la thèse androgyne développée dans le Zohar.
Lilith dont le nom est mentionné une seule fois dans la Bible (Isaïe 34 : 14) « Là se rencontreront chats sauvages et chiens sauvages, là les satyres se donneront rendez-vous, là Lilith elle-même établira son gîte et trouvera une retraite tranquille » serait la femme non nommée du premier récit de la création, née de la césure de l’être originel androgyne, l’égal de l’homme. Ce personnage tire son origine de la démonologie babylonienne qui mentionne des esprits maléfiques appelés Lilou, entité masculine et Lilitou entité féminine. On retrouve ce personnage démoniaque de Lilith dans le Talmud comme une créature ailée, à la longue chevelure qui vient tourmenter dans leur sommeil les hommes qui dorment seuls. Une superstition juive affirme que Lilith est particulièrement nuisible aux nouveau-nés, d’où l’usage de fabriquer des amulettes qui les protègent.
Cette diabolisation de la première femme d’Adam est explicite dans le Talmud de Babylone, dans l’alphabet de Ben Sira (un texte rédigé à l’époque des géonim, les présidents des académies babyloniennes du VI au XI ème siècle) ainsi que dans le Zohar, appelé livre de la splendeur, ouvrage majeur de la mystique juive, texte fondamental de la kabbale : ces textes relatent clairement la revendication égalitaire de Lilith face à Adam aboutissant à une séparation et au départ de Lilith qui s’envole dans l’espace après avoir prononcé le nom divin. Lilith, insoumise refusa de suivre les anges envoyés par Dieu à la demande d’Adam et fut maudite: sur sa tête 100 enfants mourront chaque jour.
Le fait de refuser la soumission à l’homme et de préférer la solitude à celle-ci la rend maudite, comme une image inversée d’Eve dont le nom vient de la racine vie (hava), mère de tous les vivants (Genèse 3 ;20). Lilith au contraire paie sa volonté de liberté : elle donnera la mort au lieu d’être mère. De plus alors qu’Adam demande l’aide de Dieu elle se bat seule et ne se plaint pas.
La tradition juive a en quelque sorte coupé les ailes de Lilith, transformée en démon et au contraire de la tradition babylonienne n’a gardé dans ce personnage que l’aspect féminin du démon qui au départ était masculin et féminin .
Ainsi est effacée l’égalité première entre homme et femme contenue dans le premier récit de création : finalement la première femme ne sera pas la compagne d’Adam. La relation ne peut perdurer que si elle s’inscrit dans un rapport de domination d’un individu sur l’autre.
Et pourtant certains commentateurs disent le contraire :
Rashi, le plus illustre des commentateurs de la Torah et du Talmud, né à Troyes en 1040, écrit dans Yevamot 63a que « si l’homme le mérite son épouse lui sera une aide, s’il ne le mérite pas elle sera contre lui. »
Samson Raphaël Hirsch, né en 1808 à Hambourg, un des dirigeants juifs les plus marquants de l’Europe du XIXème siècle tenant d’un judaïsme des plus orthodoxe écrit : « la parfaite égalité entre homme et femme est scellée à jamais du fait de la création de la femme à partir d’un dédoublement de ce qui ne formait à l’origine qu’une seule créature »
Dans le Zohar est développée la thèse androgyne de la création de l’homme et de la femme à partir de l’analyse du verset 26 du chapitre 1 de la Genèse « faisons l’homme à notre image, Dieu créa l’homme dans son ombre (sa trace) à l’ombre de Dieu il le créa : masculin et féminin il le créa », le passage du singulier au pluriel montre que l’image de Dieu en l’homme est le masculin et le féminin. C’est dans la relation entre masculin et féminin que se trouve l’image de Dieu sans aucune mention d’une quelconque hiérarchie de l’un sur l’autre.
On voit donc combien il serait présomptueux de prétendre trouver dans les textes de la Torah un fondement indiscutable de la supériorité masculine présumée et combien la multiplicité des interprétations possibles ne permet aucune conclusion péremptoire.
C’est ce que le rabbin et philosophe Marc Alain Ouaknine nomme le complexe de la pomme : « j’appelle complexe de la pomme cette attitude face au monde et au savoir qui donne lieu à la transmission de préjugés de on dit, d’images et d’idées fausses, jamais vraiment réinterrogés et qui deviennent un savoir populaire faisant office de vérité ».
En effet il est frappant de constater que si dans l’imagerie populaire le fruit défendu est une pomme celle-ci est totalement absente de la bible hébraïque. Le mot pomme a surgi dans un jeu de mots propre à la langue latine. La traduction en latin dans la Vulgate au IVème siècle de l’arbre de la connaissance par « lignum scientiae oni et mali » a confondu les mots mal et pomme qui se disent tous deux malum, conjugué ici mali. C’est ainsi que l’épisode originel de la transgression de l’interdit divin sera mis en scène une fois pour toutes avec Eve la pécheresse croquant la pomme, empêchant toute possibilité de nouvelle interprétation.
Si on s’intéresse maintenant plus particulièrement au rôle de la femme dans la pratique du culte et dans l’étude de la Torah on ne trouve pas dans le texte de celle-ci de liste de mitsvot (commandements religieux) dont les femmes seraient exclues ou simplement dispensées.
Ce sont les commentaires rabbiniques qui essaient de trouver un principe logique de répartition entre les deux sexes qui s’appliqueraient à tous les commandements. Selon le Talmud, traité Kiddoushim, les femmes sont dispensées des commandements positifs liés au temps avec toutefois un nombre considérable d’exceptions.
Ces dispenses concernent le fait de souffler le choffar , d’être assise dans la soucca, de porter des vêtements rituels ou de dire les prières régulières. Avec des exceptions à ce principe comme l’obligation d’assister à l’allumage du chandelier de Hanoukha et à la lecture de la meguila de Pourim qui sont pourtant des commandements positifs liés au temps.
Concernant les obligations des femmes vis-à-vis des lois positives non liées au temps elle sont identiques à celles des hommes.
Aucune explication n’est donnée quant aux exemptions destinées aux femmes.
Le Pr Liliane Vana, docteur en sciences religieuses, spécialiste en droit hébraïque, talmudiste et philologue, livre son analyse sur la nature et le sens des exemptions dans le numéro 157 de la revue Tenoua’, éditée par le MJLF. Il est important de préciser que le Pr Vana appartient au mouvement orthodoxe et c’est du point de vue de la halakha orthodoxe qu’elle s’exprime. Le Pr Vana cite le traité Kiddoushin du Talmud qui divisent les 613 commandements religieux ou mitsvot en commandements positifs ou prescriptions et commandements négatifs ou interdictions, les femmes étant dispensées des lois positives liées au temps. Elle précise que bien que l’on ne trouve aucune raison à ces dispenses dans les textes talmudiques les commentateurs ont essayé plus tard d’en donner des explications personnelles, diverses et nombreuses.
Pour le Pr Vana ces exemptions sont étonnantes pour 3 raisons :
-d’abord parce qu’en-dehors de quelques rares cas, la Torah n’exprime aucune distinction entre homme et femme quant à l’accomplissement des mitsvot
-ensuite parce que le fondement halakhique n’est pas commun à toutes les exemptions
- enfin parce que nombreuses sont les exceptions à cette prétendue règle.
De fait concernant les commandements positifs liés au temps cités plus haut dont la femme est dispensée (comme sonner le choffar à Roch Hachanah, résider sous la soucca ou réciter le chema):le texte biblique non seulement ne fait aucune mention de distinction entre les sexes pour leur accomplissement mais on peut s’étonner que la femme soit dispensée de la récitation du chema, prière qui énonce les principes fondateurs du judaïsme que sont l’acceptation du joug des mitsvot et la croyance en un Dieu unique.
Paradoxalement le femme n’est pas dispensée d’autres commandements liés au temps comme le kiddoush du shabbat,la lecture de la Meguila lors de la fête de Pourim l’allumage des lumières de Hanoukha ou l’obligation de manger de la matsah à Pessah.
Le Pr Vana s’interroge sur la cohérence qui a guidé ces choix : qu’ont donc en commun les commandements positifs liés au temps dont la tradition exempte les femmes ?
Pour le comprendre il faut au préalable rappeler un principe halakhique : lorsqu’il s’agit d’un commandement que l’homme ainsi que la femme sont tenus d’accomplir chacun peut rendre l’autre quitte de l’accomplissement de ce commandement. Ceci n’est pas le cas évidemment lorsque la femme en est dispensée : l’homme doit alors accomplir lui-même ces commandements, la femme ne pouvant l’en rendre quitte en l’accomplissant à sa place.
En analysant la liste des dispenses le Pr Vana constate qu’en l’absence d’exemption les femmes se trouveraient dans des situations où elles seraient publiquement l’égale de l’homme. Ainsi si par obligation elle sonnait le choffar elle rendrait toute personne présente dans la synagogue quitte de son obligation y compris les hommes.
De même concernant la lecture de la Torah pendant l’office, originellement selon des sources rabbiniques anciennes les femmes pouvaient faire partie partie des sept personnes de la communauté pouvant participer à cette lecture. Par la suite les rabbins interdirent cette montée en invoquant l’honneur dû à la communauté. Que signifie à cause de l’honneur dû à la communauté : voici l’explication du Choul’han Arou’h, un code de Loi rédigé au XVIe siècle par Joseph Caro (Ora’h Haïm, chapitre 282-3) : »Car il pouvait se trouver dans la synagogue des hommes qui ne savaient pas lire dans la Torah et ils auraient eu honte devant des femmes plus érudites.. »Il s’agit donc d’un décret contre les femmes à cause de l’ignorance de certains hommes..
Pour certains commentateurs médiévaux comme David Ben Joseph Aboudarham, rabbin du XIVème siècle : »La raison pour laquelle la femme est exemptée des commandements positifs liés au temps est que la femme est liée à son mari pour accomplir ses volontés ». La femme se trouve donc dans une double position de subordination : à la fois vis-à-vis de Dieu puisqu’elle est sous le joug des mitsvot et à la fois vis-à-vis de son mari à qui elle doit se consacrer. Le créateur l’aurait donc exemptée de certains commandements afin qu’elle ne néglige pas son mari : Dieu cède pour que la paix entre mari et femme soit préservée
On voit donc que cette exemption est la conséquence du statut de subordination de la femme vis- à-vis de son mari. A partir du moment où il n’y a plus de relation de subordination de la femme vis-à-vis de l’homme il devient nécessaire de remettre en question ce principe d’exemption.
Pourtant ce statut d’infériorité n’a pas été vraiment remis en question par les mouvements autres que libéraux et massorti qui l’ont aboli lors de la conférence rabbinique de Breslau en 1846.
C’est pourquoi au XXIème siècle le port du talit (vêtement rituel) par les femmes du Kotel suscite des réactions violentes qui n’ont rien à voir avec un non-respect de la loi juive mais sont d’ordre essentiellement sociologique et sexiste. Preuve en est la déclaration de Yaaqov Ariel ,rabbin de Ramat Gan ,ex-candidat au grand rabbinat d’Israël qui a dit qu’une femme est autorisée à porter le tallit à condition qu’il ne s’agisse pas d’une revendication égalitariste..
Et ce alors même que Maïmonide il y a 700 ans et Rashi au Moyen-Age approuvaient le port du tallit par les femmes !
Ces exemptions transformées en interdictions relèvent donc bien d’une volonté persistante de contenir des revendications bien légitimes et n’ont pas de fondements halakhiques.
Je m’intéresserai à deux autres exemples d’interprétation de la halakha qui aboutissent à un véritable ostracisme vis-à-vis des femmes.
Il s’agit en premier lieu de la bénédiction récitée tous les matins par les juifs orthodoxes : « Béni sois-tu Eternel notre Dieu ,roi de l’univers qui ne m’ a pas fait femme » les juifs libéraux l’ayant supprimée de leur liturgie lors de la conférence rabbinique de Breslau en 1846 et l’ayant remplacé par la bénédiction suivante : « Qui m’a fait homme » dite par les hommes et « Qui m’ a faite femme « dite par les femmes ou par « Qui m’ a fait à ton image », ce qui correspond au texte de Genèse 1-27 .
Voici l’analyse du rabbin Pauline Bebe : « Cette bénédiction est apparue dans les livres de prières de l’époque talmudique. Une tentative de justification de cette pratique apparait dans la Tossefta (mot araméen qui signifie complément) qui est une collection d’enseignements complétant ceux de la michnah (elle-même compilation des commentaires de la Torah sous tous ses aspects :halakhot, midrachim, haggadot).Rabbi Yehouda dit qu’il faut ajouter deux autres bénédictions à celle-ci : remerciant Dieu de ne pas m’avoir fait non juif et pas ignorant .
Pourquoi ? : non-juif parce que les nations sont comme rien devant toi , femme parce qu’une femme n’est pas tenue d’observer les commandements, ignorant parce qu’un ignorant ne craint pas la transgression ».
De fait ces bénédictions impliquant une supériorité de celui qui les prononce par rapport aux trois catégories énoncées on peut se demander pourquoi ne pas simplement remercier Dieu d’être obligé d’accomplir les commandements plutôt que de donner une image négative d’autrui. D’autre part comme dit plus haut l’accomplissement des commandements a toujours été considéré comme un privilège, ce qui dans ce domaine situe la femme dans une position d’infériorité.
Même si les discours apologétiques modernes prétendent que les femmes n’ont pas besoin d’accomplir les commandements parce qu’elles seraient plus parfaites ou plus proches de Dieu c’est aussi une manière de les exclure du monde du rituel sans leur demander leur avis ».
Pour le rabbin Pauline Bebe la formulation, même si rabbi Yehouda a cherché à la justifier de manière positive, reste problématique pour trois raisons :
-à l’époque talmudique il existait une fluidité de la liturgie et le fait que dans le Talmud de Babylone apparaisse une variante de ces bénédictions montre que le texte lui-même était sujet à discussion
-la liturgie était censée refléter la pensée dans un souci d’adéquation entre les mots et l’esprit, par honnêteté intellectuelle cette bénédiction aurait dûe être reformulée
-il existe dans le judaïsme une interdiction éthique de causer du mal par des mots (ona’ath devarim).
Encore une fois la prise en compte du contexte de l’époque où le statut de la femme est proche de celui de l’esclave ainsi que l’application des principes énoncés ci-dessus auraient dû en toute logique amener les rabbins orthodoxes à revoir les termes de cette bénédiction. Or il n’en est rien : des changements ont été introduits en remplaçant la bénédiction concernant les ignorants par une bénédiction sur les esclaves, certains rabbins ont préféré la formulation positive : « qui m’a fait Israël « à la version négative « qui ne m’a pas fait païen » mais en ce qui concerne les femmes rien n’a changé !
Le rabbin, philosophe et talmudiste Marc-Alain Ouaknine recherche lui une version alternative de cette bénédiction ; il insiste sur la nécessité de reformuler ces bénédictions du matin qui nous sensibilisent à la perception des différences : différences de nature homme-femme, différences de culture (juif-autre peuple), différence de situation (libre-esclave). Différences pour lui fondamentales dans la construction de tout sujet humain.
Marc-Alain Ouaknine reprend la première bénédiction : « Tu es source de bénédiction qui a donné au coq l’intelligence (bina) de faire la différence entre jour et nuit « .Pour lui cette bénédiction inaugurale est comme une clef de partition, elle donne la tonalité. En effet l’intelligence est l’action de discerner par les sens (le latin intellectus vient de intelligo qui précise un mouvement à la fois de rassembler, accueillir, mettre ensemble et aussi mettre de l’écart, de l’espacement , de l’entre). Pour lui ces bénédictions introduisent dans le langage matinal, dans le lexique du « lever » (il faudrait peut-être dire dans le lexique qui aide à se lever) le vocable « non », « lo » en hébreu. Il faut donc pour reformuler ces bénédictions leur trouver une expression qui continue à assumer en elles à la fois l’écart différentiel et la négation sans ostraciser l’autre. Un vaste chantier …
Un deuxième sujet qui est devenu un vrai problème de société en Israël et aussi en diaspora, source de conflits juridiques et de souffrances pour les femmes est celui du guet ou divorce religieux.
Le film réalisé par Schlomi Elkabetz et sa sœur Ronit, actrice talentueuse décédée en 2016 intitulé « Gett, le procès de Viviane Amsalem » et qui fait partie d’une trilogie avec deux autres films (« Prendre Femme » et « Les sept jours ») suit le combat d’une femme dans le huis clos d’un tribunal rabbinique où elle tente d’obtenir le divorce. C’’est la première fois qu’il a été possible de filmer ce qui se passe dans les tribunaux rabbiniques et ce film a déclenché beaucoup de réactions et de débats. Il pose la question suivante : comment solutionner le conflit permanent entre des repères anciens et les principes d’un pays démocratique ? Voici quelques éléments qui contribueront à éclairer ce sujet complexe :
Concernant le fondement biblique il n’existe pas de législation systématique sur le divorce. Néanmoins deux principes fondamentaux sur ce sujet figurent dans le Talmud : »Quand un homme prend une femme et l’épouse, s’il arrive qu’elle ne trouve pas grâce à ses yeux parce qu’il a trouvé en elle quelque chose de choquant, il lui écrira une lettre de divorce et la lui mettra en main puis il la renverra de sa maison ». Ainsi le droit de divorcer appartient exclusivement au mari et l’acte de divorce doit présenter la forme d’un document écrit.
Que signifie le mot « choquant » ? Selon l’école de Chammaï, il fait référence à l’infidélité, selon l’école de Hillel, la phrase signifie : même si elle lui a déplu en brûlant le repas. Rabbi Aqiva va même plus loin en déclarant qu’un homme peut répudier sa femme s’il en trouve une plus jolie !
Il existe deux cas dans lesquels l’homme ne peut jamais divorcer : s’il a accusé à tort sa femme de ne pas avoir été vierge au moment de son mariage et s’il avait violé une vierge qu’il avait épousée par la suite.
On voit donc que la Bible place le droit de divorcer uniquement dans les mains du mari. Pourtant des documents trouvés dans la colonie d’Eléphantine, en Egypte au VIème siècle avant notre ère indiquent que la femme avait également le droit de demander le divorce, peut-être une pratique liée à une influence étrangère.
Selon le Talmud, (traité Sanhédrin) « l’autel verse des larmes pour l’homme qui répudie sa femme » et à l’époque talmudique la loi sur le divorce subit des modifications significatives. Dans un certain nombre de circonstances le tribunal peut contraindre le mari à accorder le divorce :
-en cas d’absence d’enfant au bout de 10 ans de mariage
-si un mari contracte un mal répugnant
-si un mari refuse d’entretenir sa femme
-si un mari refuse à sa femme ses droits conjugaux
-si un mari continue de battre sa femme tout en ayant été averti par le tribunal d’avoir à cesser de le faire.
Ces clauses conditionnelles posent problème puisqu’elles semblent aller à l’encontre de la loi d’après laquelle si un homme peut répudier sa femme contre la volonté de celle-ci, il ne doit pas agir sous la contrainte quand il lui donne l’acte de divorce. Dans la mesure où tout dépend de la volonté de l’homme comment appliquer ces clauses conditionnelles ?
Le Talmud résout le problème en affirmant que l’homme doit être contraint par le tribunal même par l’application de la force dans les cinq situations ci-dessus jusqu’à ce qu’il dise : « Je veux divorcer d’avec ma femme ».
De fait en Israël les tribunaux rabbiniques n’usent pas eux-mêmes de coercition mais parfois remettent le mari qui refuse de se plier à la décision du tribunal rabbinique aux autorités séculières qui le détiennent en prison jusqu’à ce qu’il se plie à cette décision.
Le rabbin Pauline Bèbe note un changement dans la halakha qui a représenté une grande avancée pour la femme au Moyen-Age avec l’interdiction du divorce contre la volonté de la femme, un tel divorce étant nul et non avenu.
Par ailleurs les interprétations au cours du temps des clauses conditionnelles citées plus haut qui permettent à la femme d’obtenir le divorce auprès du tribunal rabbinique sont très diverses et vont jusqu’à faire une différence entre les violences conjugales à valeur éducative et les autres..
Le résultat de ce refus des rabbins orthodoxes de réinterpréter la halakha sur ce sujet, alors même que cela a été fait dans les siècles précédents aboutit à des situations dramatiques pour des milliers de femmes qui n’arrivent pas à obtenir le divorce de la part de leur mari et ne peuvent donc se remarier religieusement. En cas de remariage elles sont considérés au regard de la halakha orthodoxe comme adultères et les enfants issus de cette nouvelle union comme illégitimes (mamzerim) alors que l’homme non divorcé religieusement peut lui se remarier religieusement et ses enfants seront reconnus comme légitimes .
Ce déséquilibre entre le statut de la femme et celui de l’homme en matière de mariage et de divorce est très grave pour la femme dont le mariage a pris fin mais qui reste légalement mariée : elle est appelée « agouna », son mari avec qui elle ne vit plus reste légalement responsable d’elle.
Ce sujet a beaucoup préoccupé les rabbins partagés entre la volonté de sortir les « agounot » de cette impasse légale et l’appréhension de transgresser la loi en permettant à une femme non libérée de son premier mariage de commettre un adultère si elle se remarie avec un autre homme.
Actuellement le problème des agounot est réglé dans le mouvement massorti et dans le mouvement libéral : pour le premier, le divorce civil est automatiquement entériné par le tribunal rabbinique et pour le second les actes de de divorce (ou guet) sont égalitaires puisque la femme peut, comme l’homme, être à l’’initiative du divorce. Le problème reste entier dans le mouvement orthodoxe, l’égalité en droit des hommes et des femmes dans le domaine religieux restant toujours controversée alors même que les ancêtres des décisionnaires actuels avaient plus d’audace qu’eux .
Le judaïsme au féminin
Malgré leur statut d’infériorité les femmes et le féminin sont omniprésents dans les textes de la tradition juive.
Les héroïnes bibliques en sont la preuve qui s’illustrent par leur capacité à jouer un rôle public et politique. Plusieurs sont décrites comme des prophétesses dont la parole, les actes et les chants guident le peuple. Parmi elles, Esther, Myriam, Salomé Alexandra, Deborah, Rebbeca, Sarah ou Berouria.
Le rabbin Delphine Horvilleur fait remarquer que le ton à l’égard des femmes change radicalement aux premiers siècles de notre ère : les écrits rabbiniques et ceux des premiers chrétiens semblent réorienter le rapport au féminin et à la femme, sans doute sous l’influence du monde gréco-romain. Ainsi la littérature juive de cette époque est à l’image de son temps : une invitation à maîtriser ou à domestiquer la femme. Delphine Horvilleur s’interroge légitimement sur ce que seraient les métaphores et le langage des textes des trois religions monothéistes s’ils avaient été lus et commentés avec des femmes. L’interprétation exclusivement masculine expliquerait en partie pourquoi le sacré prend dans cette littérature les traits et les atours du féminin.
A quoi ressembleraient le sacré et la vérité si les femmes avaient été invitées à mêler leur voix aux commentaires ? Les lectures souffrent-t ‘elles de ce que le rabbin Naama Kalman appelle un excès de testostérone ? Au contraire le féminin et ses symboles procurent-t ‘ils le seul langage capable de dire le sacré et le mystérieux pour les hommes comme pour les femmes ?
En tout cas comme on l’a vu plus haut le féminin est présent dès le début de la Genèse et le peuple d’Israël prend souvent les traits d’une femme avec laquelle Dieu tisse une relation d’intimité dans bien des occasions : lors de l’arrivée du shabbat la fiancée Israël attend son bien-aimé, de même les commentateurs ont fait du Cantique des Cantiques une lecture allégorique mettant en scène le bien-aimé Dieu et sa fiancée, le peuple d’Israël, qui se cherchent, se désirent, se courtisent et se manquent. Selon Delphine Horvilleur le livre d’Osée est sans doute dans le canon biblique le plus explicite en la matière : il se veut une allégorie du lien endommagé mais réparable de Dieu à son peuple, d’une relation malmenée par les traîtrises et les débauches d’une femme.
De même Delphine Horvilleur voit dans la pose des téfilines (lanières de cuir où est placé un boîtier avec un petit parchemin) une allégorie d’un mariage de l’homme avec le Dieu-époux par sa gestuelle et par son texte.
.
GA Morali écrit dans « Kabbale, corps et âme » que la grandeur de l’être Israël c’est de savoir qu’il n’est que le féminin de Dieu, partenaire femelle par rapport au divin. En effet les interprétations allégoriques qui mettent en scène le féminin sont multiples dans la Kabbale.
Il semble donc que la posture de féminité dans laquelle se présente l’homme juif ne pose pas problème aux rabbins.
Un autre thème relatif au féminin , celui de la maternité et de l’enfantement, revient de manière récurrente comme une allégorie de la création artistique qui aurait à voir avec une transcendance.
La pianiste Hélène Grimaud dit ceci : « L’art tutoie l’âme var c’est à l’âme qu’il s’adresse. Jamais l’homme n’est plus libre que lorsqu’il crée, là se trouve la cachette de Dieu »
Sur ce sujet du lien entre le féminin maternel ,la création et la transcendance j’évoquerai le travail remarquable de la cinéaste Nurith Aviv,( première chef opérateur en France et qui a travaillé entre autres avec Amos Gitaï et Agnès Varda ) à partir du langage, de l’image et du texte biblique . Dans son film « Annonces « réalisé en 2013, elle esquisse le portrait de sept femmes qui composent sur le même thème : elles prennent pour point de départ les réactions des annonces faites à Agar, à Sarah et à Marie. Chacune de ces femmes en y mêlant sa prophétie, ses mythes personnels, tire le fil de ses associations à travers la mythologie, l’histoire de l’art, la poésie, la philosophie, la psychanalyse. Ces femmes mises en scène, juives, chrétiennes, musulmanes ou athées parlent des annonces faites à ces trois femmes de la Bible et du Coran ;or le mot « annonce » en hébreu vient de besora qui signifie chair : annonce et incarnation sont le même mot.
On peut donc dire que ces trois femmes sont investies par Dieu, enceintes de Dieu : c’est en ce sens que la psychanalyste Julia Kristeva parle de maternité comme part inséparable de l’alliance avec le divin. Pour elle dans le monothéisme l’intériorisation du divin se fait par le maternel et aussi par la loi. En effet Moïse lui-même est investi par la voix divine entrée dans son corps et il porte son peuple comme on porte un enfant.
La maternité étant aussi ce qui nous dépasse incarnation et alliance sont habités par la transcendance.
Comme l’écrit le rabbin Adin Steinsaltz, maître talmudique qui a traduit les deux Talmud depuis l’araméen en cinq langues, le Talmud est « un livre organique, vivant comme un arbre, il est signe de vie car la discussion qu’il initie perdure encore …Dans le Talmud il existe au moins une quarantaine de termes pour le mot question, selon la nature des questions, selon le contexte dans lequel elle est posée. C’est un livre saint pour la tradition juive mais sans les attributs d’un tel ouvrage : il est en lui-même une contradiction, c’est un intellectualisme saint, qui repose sur la liberté de pensée, de poser des questions sur tout «
Ainsi sur le thème midrashique de la femme et du féminin dans la tradition juive on pourrait continuer à tirer le fil en déroulant et en explorant la multitude des possibles sans jamais arriver à épuiser le sujet.
Autonomie personnelle et vie juive, Rabbin Miriam Berger, Londres, traduit par Daniela Touati, étudiante rabbin (promotion 2019)
Tous les jours, je rencontre des personnes qui ne comprennent pas le sens du judaïsme libéral[1]. La plupart d’entre-eux sont membres de synagogues libérales, d’autres essaient de démontrer le manque d’authenticité du judaïsme libéral comparativement aux autres dénominations.
Il est clair qu’ils ne comprennent pas ce qu’est le judaïsme libéral quand ils le décrivent uniquement au travers de sa pratique : dans le judaïsme libéral les hommes et les femmes peuvent être assis côte à côte, conduire le shabbat ou manger dans des restaurants non- Cacher.
Bien que ces faits puissent être des conséquences, ce ne sont pas des définitions. Le judaïsme libéral ne se définit pas par une série de pratiques mais plutôt comme un processus de prise de décision qui a des implications différentes selon ses membres, ses rabbins et leurs communautés.
Le judaïsme libéral est une des formes les plus traditionnelles du judaïsme, car il continue la conversation avec laquelle nous sommes familiers à partir des textes du Talmud et de la littérature des responsa. Le judaïsme a toujours été et continue à être défini par le fait qu’il existe un débat. Il s’agit de prendre des textes anciens et explorer leur sens dans le contexte actuel. Il y a toujours eu une conversation, que ce soit concernant la compréhension de la prière après la destruction du Temple ou le concept de Shmitta lorsqu’on vit en diaspora, qui tient en tension le pouvoir du passé et de la tradition d’un côté, et les considérations du monde actuel. Le judaïsme libéral nous donne un cadre qui nous permet de continuer à faire partie de ce dialogue en créant le judaïsme d’aujourd’hui.

Le judaïsme Reform anglais a cherché à deux reprises à formuler les facteurs qui ont un impact dans ce dialogue permanent. Le rabbin Tony Bayfield a initié cette conversation (entre pratique du judaïsme et prise de décision) dans son livre « Sinaï, Loi et Autonomie responsable » publié en 1993, puis en 2012 avec le lancement du programme d’éducation du mouvement Reform « LeChaïm ». Tony Bayfield définit cette conversation en la schématisant avec deux triangles équilatéraux. Je pense que la forme est primordiale pour cette explication, et ceci pas seulement du fait que deux triangles équilatéraux placés l’un au-dessus de l’autre forment une ‘Magen David’ (étoile de David), mais parce que cette forme aide à expliquer en quoi c’est légitime pour ma pratique du judaïsme de prendre une position légèrement différente de la vôtre.
En résumé, chaque côté du triangle représente un aspect du processus de prise de décision. A première vue, chaque côté des triangles a un poids identique. Cependant un aspect fondamental du judaïsme libéral est que chacun doit avoir cette conversation avec lui-même et ne peut compter sur les décisions qu’un rabbin prendrait pour lui. Evidemment, ce qui en découle est qu’il y aura une différence entre ce à quoi je choisis de donner davantage de considération, et ce à quoi d’autres choisiront de donner de l’importance. Et vice versa.
Ce qui fait de nous un mouvement cohérent du judaïsme est notre adhésion à l’idée que la prise de décision et le débat doivent être mis en commun, alors que les conclusions ne seront pas forcément partagées par tous.
La clé de ce processus est de comprendre les facteurs qui doivent faire partie de ce dialogue intérieur. Ces facteurs peuvent être par exemple, les trois composantes du cours LeChaim : « communauté, sagesse et sainteté ». Ou bien les six facteurs du triangle du rabbin Tony Bayfield. photo
Dans les deux cas de figure, la décision doit être prise dans un cadre intellectuel responsable et réfléchi.
Dieu, la Tradition et la Communauté juives font partie de notre identité juive et doivent prendre part dans le débat concernant notre identité juive.
Lorsque nous disons que Dieu devrait faire partie de cette prise de décision, nous n’attendons pas la manifestation d’une voix stridente ou d’un signe matériel, mais plutôt, nous trouvons cette « voix » de Dieu en prenant en compte l’impératif moral ou bien la manière dont cela approfondit notre foi ou notre vie spirituelle. La tradition juive est très terre à terre parfois. Avons-nous des textes pour nous guider ou bien une tradition qui nous a été transmise à travers les générations ? La vie communautaire est ce qui garantit que nous ne créons pas un judaïsme personnel qui ne ressemble à aucun autre.
La vie communautaire met en lumière à la fois les aspects qui nous rassemblent et aussi ce qui nous est unique. Ces trois facteurs (Dieu, Tradition et Communauté) ne peuvent être séparés parce qu’ils représentent l’identité juive, mais cette identité est soumise à d’autres facteurs. Le sens moral ne vient pas uniquement de « notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres » mais aussi d’un sens plus global de ce qu’est la moralité. Notre sagesse ne vient pas seulement de nos textes mais aussi de la science, de l’expérience, de l’histoire, de l’art et de la culture. La tradition juive ne peut être la seule base de notre sagesse dans ce dialogue. La communauté juive n’est qu’une partie de la communauté au sens large. Nous impactons la société par nos décisions et nous sommes influencés par elle. Si l’une des raison-d’être du judaïsme est de créer une société plus juste pour tous, la réussite de ce projet est de faire dialoguer le monde juif et le monde en général.
Les pratiques du judaïsme libéral sont le résultat d’un dialogue entre la sagesse juive et la sagesse du monde en général, entre la communauté juive et la société à laquelle nous appartenons au sens large, mais aussi la sainteté qui a une « saveur » spécifiquement juive ainsi que la spiritualité et l’éthique qui constituent l’humanité.
Il est vital que nous comprenions que le passé a un droit de vote et non un droit de véto. Cela est vrai pour tout débat concernant le judaïsme. Tout comme le judaïsme Haredi d’aujourd’hui ne ressemble pas au judaïsme du 2e siècle à Jérusalem, de même les pratiques actuelles des synagogues consistoriales[2] ne ressemblent pas à celles de la Lituanie du 16è siècle. Il est évident que ce changement est continu et répond à la vie actuelle. Les rabbins du Talmud s’accordent sur le fait que Moïse ne pourrait reconnaitre leurs innovations. Et je suis certaine que, de la même façon, les rabbins du Talmud seraient surpris par le judaïsme tel qu’il s’est développé depuis le temps de Maïmonide et de Joseph Caro, et en particulier depuis l’Emancipation.
Il y a une variété de raisons à l’origine du besoin de revoir les décisions concernant la pratique du judaïsme. Le contexte social dans lequel nous vivons comme par ex. les questions de genre et de sexualité est différent. Les connaissances dans certains domaines comme celui du traitement de la fertilité, ou de la mort assistée ont progressé ; la pratique et l’éthique en ce qui concerne l’abattage des animaux ont évolué.
Alors quelles voix du passé ont-elles un droit de vote et quelle voix du présent est légitime pour préserver la perspective juive ? Pour chaque décision, que ce soit notre compréhension de la cacherout ou l’accord donné à la mise en œuvre d’un nouveau traitement médical, les mêmes facteurs doivent être pris en compte, tandis que le poids que nous donnons à chaque facteur est la clé qui nous donne accès à notre autonomie de décision.

Patrilinéarité et matrilinéarité - Identité juive
Judaïsme libéral au sujet du statut juif et de la descente en ligne directe par l’un de deux parents (patrilinéarité et matrilinéarité)
Par le rabbin Alexandra Wright, co-présidente de la Conférence du judaïsme rabbinique
Le judaïsme libéral reconnaît une descendance en ligne directe par l’un des deux parents à savoir que les individus nés d’un père juif et d’une mère non juive devraient être traités exactement de la même façon que les individus nés d’une mère juive et d’un père non juif.
Les affirmations du judaïsme libéral indiquent que les enfants issus d’unions mixtes entre une personne juive et une personne non juive doivent être traités de la même façon et considérés comme juifs s’ils ont été éduqués dans le judaïsme.
C’est approximativement depuis 1955 que le judaïsme libéral accepte les enfants soit d’une mère juive soit d’un père juif à condition qu’ils aient reçu une éducation juive dans le contexte d’une synagogue. Le mouvement réformé américain évoquait la patrilinéarité dès 1929.
La présomption d’identité juive pour un enfant dont l’un des parents est juif – que ce soit le père ou la mère –est confirmée lorsque l’enfant atteint l’âge de la Bar-mitsvah ou la Bat Mitsvah.
Il n’y a pas de certificat, pas de conversion, pas de Bet Din ni de détermination rabbinique du statut de l’enfant mais une reconnaissance tranquille que le jeune adolescent est membre à part entière de la communauté juive, qu’il n’a jamais été autre que juif et qu’un seul parent – avec l’éducation (et non la religion de l’autre parent) – a déterminé son statut juif.
En temps utile, si l’enfant souhaite épouser quelqu’un qui est juif, le couple pourra célébrer le mariage sous une Houppa avec une Ketouba dans une synagogue libérale.
Les couples et les familles avec des éléments mixtes sont les bienvenus et inclus dans la vie des congrégations du judaïsme libéral et la possibilité existe pour des couples mixtes d’officialiser leurs unions avec un acte de prière dirigé par un rabbin et, là où c’est possible d’être enterrés ensemble dans nos cimetières.
Le besoin d’être inclusifs dans notre attitude par rapport à l’identité juive, de recevoir des conversions sincères et de ne pas rendre le processus de conversion plus difficile qu’il ne doit être, est central par rapport aux valeurs de compassion et de justice du judaïsme.
Les synagogues libérales sont des lieux où les familles mixtes peuvent se sentir à l’aise et bienvenues et où les enfants ne sont jamais exclus pour avoir voulu explorer et approfondir leur identité juive. Ce qui est très important également, c’est que leurs parents – juifs et non juifs puissent participer aux cérémonies du cycle de la vie, explorer le judaïsme dans des classes et par des conversations privées avec leur rabbin, se convertir s’ils le souhaitent et aider à aider à élever un enfant juif.
Voici des témoignages exprimés par les enfants d’un couple mixte. Sans le soutien des deux parents, ils auraient été perdus pour le peuple juif. Les noms ont été changés pour préserver leur anonymat.
Saul a 12 ans et a suivi les cours de religion à la synagogue libérale depuis presque 8 ans, depuis l’âge de 4 ans. Son père, Marc, est juif, sa mère, catholique non pratiquante mais elle le soutient dans sa démarche et lui permet d’assister aux classes de la synagogue pour approfondir son identité juive.
Assis dans mon bureau il y a quelques semaines, Saul est nerveux mais désireux de devenir Bar Mitsvah l’année prochaine. Son père et sa mère sont tous les deux présents et nous parlons de la signification de la Bar Mitsvah et de la partie de la Torah qui la concerne (parasha), extraite du lévitique. Il est capable d’acquérir des connaissances, sensible et il ressent son identité juive profondément et avec fierté.
Les parents de Saul se sont séparés après sa naissance. Il n’est pas possible que la mère se convertisse mais elle est intéressée et souhaite aider son fils à célébrer sa Bar Mitsvah.
Aux yeux des membres plus traditionnels de la communauté juive anglaise, Saul n’est pas considéré comme juif parce que sa mère n’est pas juive même s’il a eu une éducation juive et qu’il célèbre Chabbat et les fêtes avec son père et sa belle-mère qui est juive. Il ne s’est jamais considéré lui-même autrement que comme juif.
Aux yeux du judaïsme libéral, Saul est présumé juif.
__
Benjamin, âgé de 30 ans, a grandi en dehors de Londres avec un père juif et une mère non juive. Leur foyer était laïc avec peu de connaissances sur la pratique et les rites juifs. Il n’a pas été éduqué formellement en tant que juif et n’a pas suivi les cours de religion, ni n’a fait sa Bar Mitzvah.
Mais il rendait visite à ses grands-parents régulièrement et se souvient avoir été occasionnellement à la synagogue avec son père à la synagogue à Yom Kippour lorsqu’il était petit.
Benjamin allait à l’école dans un lieu où il y avait peu de juifs. Même s’il sentait qu’il ne pouvait s’identifier comme juif, ses camarades voyaient les choses autrement. Il était constamment importuné dans la cour de l’école par des railleries antisémites.
Par une de ces curieuses coïncidences de la vie, Benjamin avait rencontré et était tombé amoureux d’une femme juive. Ils sont assis dans mon bureau pour parler de la possibilité d’une bénédiction religieuse mixte – une cérémonie dirigée par un rabbin à la suite d’une cérémonie de mariage civil.
Il n’y a pas de Houppa, pas de cheva bera’hot (sept bénédictions du mariage) mais le couple est capable d’imaginer un office lui-même et de créer une cérémonie qui a du sens pour tous les deux – une pratique dans le judaïsme libéral qui remonte à 2003 quand les cérémonies publiques ont été approuvées par la Liberal Rabbis’ Rabbinic Conference (la conférence rabbinique des rabbins libéraux).
Au cours de la discussion, je questionne Benjamin sur son passé et les racines de son identité juive comme enfant d’un père juif. « Je n’ai pas été élevé dans un foyer juif », dit-il. « Pendant mon enfance, j’ai passé beaucoup de temps avec ma famille et je suis conscient de mon héritage juif. J’ai été circoncis mais mon père ne pouvait pas vraiment m’expliquer pourquoi j’ai eu une Brit Mila ».
Je lui demande ce qu’il ressent à propos de la conversion ou de l’affirmation du statut juif, le premier nécessitant un programme d’études comportant des études juives et de l’Hébreu. Il décide d’y réfléchir.
Dans le cas de Benjamin, il choisit de se convertir. Il veut créer une famille juive en éduquant ses enfants comme juifs d’une façon qu’il n’a pas vécue dans son enfance ou son adolescence.
__
Dans le cas d’un autre jeune homme, fils d’un père juif et d’une mère chrétienne et qui s’est toujours vu comme un juif, allant régulièrement à la synagogue pour les fêtes, ne manquant jamais un seder à la maison, allumant les bougies de Hanoucca et avec un très fort sens de l’identité juive qui lui est venu par son père, le chemin est une affirmation du statut juif.
Bien qu’il n’ait jamais suivi les cours de religion, jamais célébré une cérémonie de Bar Mitsva et n’ait jamais pris part à une cérémonie de Kabbalat Torah à 15 ans, il n’y a aucun doute qu’il se sent complètement juif et que le rôle de la synagogue et du bet Din libéral est de valider et d’honorer ce fort sentiment d’identité juive. C’est son héritage et personne ne peut le lui enlever.
Sermon de Rosh Hashanah 5775, Rabbin François Garaï - GIL, Genève
Roch HaChanah 5775 /2014 - 1 -
Lorsque Dieu s'adresse à Abraham pour lui demander d'offrir symboliquement son fils en sacrifice, Il lui dit: kah na, èt bin'kha èt yehidekha achèr ahavta èt Yitzhak / prends, ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac (Gen 22:2). Le texte aurait pu simplement être: kakh èt Yitzhak / prends Isaac. Les commentateurs ont expliqué la raison de cette lente approche par un souci de ménager Abraham.
Et nous lisons dans le Talmud, le dialogue suivant entre Dieu et Abraham: Prends ton fils, dit Dieu, mais j'ai deux fils, Ishmaël et Isaac répond Abraham, ton unique: mais chacun est unique..., celui que tu aimes, mais je les aime tous les deux. Alors Dieu énonce le nom d'Isaac. (Sanh 89b)
Ce dialogue est une leçon au regard de ce que nous entendons aujourd'hui où l'autre est souvent enfermé dans un seul et unique vocable, dans une seule et unique définition.
Il en est ainsi de ceux que certains tribuns appellent : les étrangers. Comme si tous les citoyens d'un autre pays que le nôtre pouvaient être rangés sous ce terme les réduisant à cette qualité unique.
Dans le conflit qui a concerné Gaza et Israël, il en a été de même. Pour les uns, les autres sont des "terroristes" et, inversement, pour les autres, les uns sont des "sionistes". Sortis de ces deux catégories, palestiniens et israéliens semblent perdre toute qualité et toute réalité.
Ici ce soir, beaucoup d'entre nous sommes genevois. Cela épuise-t-il notre identité? Certains sont athées, d'autres croyants; certains sont de simples citoyens, d'autres sont des responsables politiques. Chacun a grandi, a évolué et continue à évoluer dans un environnement qui lui est particulier et multiple car familial, associatif, intellectuel, culturel et d'autres encore.
Un vocable unique ne définit pas l'autre qui est, comme chacun de nous, un individu unique mais aux multiples facettes. Parodiant Alain Finkielkraut, on pourrait dire qu'il y a des identités malheureuses lorsque l'autre est enfermé dans identité unique qui exclut le jeu des diversités.
Certes, pour affirmer ici et ce soir, ce qui nous relie on peut dire: nous sommes genevois, ou bien: nous sommes juifs. Mais là ne s'arrête ni notre identité, ni notre être.
Parler de palestiniens en les qualifiant de "terroristes", c'est les confiner dans ce rôle et, peut-être, ne pas leur permettre d'en sortir eux-mêmes car, de
Roch HaChanah 5775 /2014 - 2 -
prime abord, nous affirmons ce qu'ils sont, construisant ainsi nous-mêmes notre ennemi, pour reprendre l'affirmation d'Umberto Eco.
Hillel nous rappelle: al tadin èt havèrekha ad shétagia limkomo/ ne juge pas l'autre avant de te trouver à sa place (Avot 2:5). Se trouver à sa place, c'est essayer de concevoir ce qu'il peut penser, ce qu'il peut ressentir, c'est tenter de percevoir les multiples aspects de sa personnalité.
Alors s'ouvre un champ différent qui exige, pour parler de l'autre, l'introduction de vocables multiples et non d'un seul.
Penser l'autre, comme se penser soi-même.
Lorsque les sirènes retentissent au milieu de la nuit, penser l'angoisse de celle ou de celui qui réveille les siens pour courir aux abris. Penser l'effroi de celle ou de celui pour qui aucun abri n'a été construit. Penser la douleur de celle ou de celui qui constatent la mort de l'un des leurs.
Loin de moi de vouloir établir une proportionnalité entre ce que les uns ont vécu et vivent et ce que les autres ont vécu et vivent. La proportionnalité dans une guerre est illusoire. Si elle devait être respectée, il faudrait que, comme l'a fait remarquer le rabbin Eric Joffe, le nombre de morts et l'ampleur des dégâts soient similaires chez chaque belligérant! Cela voudrait dire que les Israéliens n'auraient jamais dû concevoir ni développer et encore moins utiliser le système sophistiqué appelé: "Dôme de fer", qui a certainement sauvé un très grand nombre de vies en Israël. La proportionnalité est une notion étrangère à la guerre, comme elle l'est dans le traitement de l'information.
Mais cela n'excuse personne. Les victimes restent des victimes pleurées par les leurs. Et nul ne peut l'oublier.
Nul ne doit oublier que les deux populations, celles de Gaza et de Cisjordanie d'une part, comme celles d'Israël d'autre part, sont des victimes. Victimes d'une situation figée conséquence d'un blocage idéologique et politique d'où découlent les positions irrédentistes des uns et des autres.
Mais revenons au texte cité plus haut. Dieu s'adresse à Abraham pour qu'il puisse identifier Isaac grâce aux divers qualificatifs mentionnés. Ce texte nous invite donc à considérer l'autre dans sa complexité.
Tant que des Israéliens qualifieront des Palestiniens de "terroristes", le dialogue avec eux sera impossible. De même, tant que des Palestiniens qualifieront les Israéliens juifs de "sionistes", ils seront englués dans leur charte
Roch HaChanah 5775 /2014 - 3 -
qui affirme que tout le territoire conquis par l'épée, au début de l'Islam, fait partie de la Oumah et qu'il ne peut donc être administré que par des musulmans et que les non-musulmans doivent se conformer aux règles édictées par la pratique historique, humiliante et ségrégative de la dhimmitude. Ce serait rendre impensable un partage de territoire entre Palestiniens et Israéliens. Ce serait conforter les extrêmes de part et d'autres dans l'idée que tout règlement est fondamentalement impossible.
Il faut donc cesser d'enfermer l'autre dans une prison sémantique qui lui interdit toute ouverture vers un autre devenir. Il faut le libérer de cette geôle sémantique, afin d'ouvrir un espace de vie.
La première qualité d'un palestinien, comme celle d'un israélien, au sens propre du terme et sans jugement de valeur, leur première qualité est d'être un être humain qui mange et qui dort, qui aime, qui pleure et qui rit, comme tout être humain, comme chacun de nous.
Nous qui sommes tous des Eve et des Adam, nous avons cette qualité rare, celle de la parole. Et cette parole peut engendrer le dialogue, ou la dispute. Mais dans quelque cas que ce soit, dialogue ou dispute, si la parole circule, la relation humaine existe et peut repousser le recours à la violence.
Voir en l'autre le mal personnifié, rend sourd et aveugle et incapable de penser le dialogue et la paix?
Penser la paix, non pas l'attendre mais la penser d'abord car cela nous rendra possible le partage de la paix avec les autres.
Pour la penser, il faut nous référer à notre socle identitaire, celui de notre Tradition; même si, par ailleurs, nos références peuvent être diverses et multiples. Ici, au sein du GIL, notre référence commune est celle de la Tradition juive et de l'enseignement de nos maîtres.
Lorsque ceux-ci composèrent la Amidah, ils décidèrent que la paix serait le sujet de la dernière bénédiction, comme une apothéose, car, pour eux, toute action humaine devrait mener à la paix.
S'agit-il de la paix entre entités politiques, s'agit-il de la paix entre citoyens ou s'agit-il de la paix que chacun doit construire pour soi?
Dans leur approche, ce dernier élément est fondamental. Au point que la
première signification qu'ils donnent au mot chalom est: le bien-être individuel (voir Brettler 179).
Roch HaChanah 5775 /2014 - 4 -
Cela semble bien égocentrique et bien matérialiste. La paix n'est-elle pas un état noble, tellement plus élevé que la notion de bien-être individuel.
Mais nos maîtres ont affirmé qu'il faut d'abord assurer les conditions d'un bien- être individuel car il permet de prendre conscience de la vie qui nous habite, de ce don qui nous a été fait et dont nous sommes dépositaire. Alors, un premier chemin s'ouvre, celui de la paix intérieure. Cela nous invite à nous élever au- dessus de certaines contingences et de ne plus nous penser comme des êtres morcelés, tiraillés par des désirs inassouvis. Cela doit nous permettre de nous tourner vers les autres car, éprouvant une certaine plénitude, n'étant plus uniquement préoccupés par nous-mêmes et ne nous pensant plus comme le centre de l'univers (voir Kushner page 180), l'ouverture vers les autres devient possible.
La conscience de la vie qui nous habite, celle du bien-être dont nous jouissons, le sentiment de paix intérieure et l'absence de toute désir inassouvi, nous libère donc de ce que nous qualifions de yétser hara, cette tentation de conquérir des espaces inconnus pour acquérir ce que nous ignorons et qui, pourtant, semble nous manquer si cruellement. Le bien-être est donc, pour les maîtres de notre Tradition, le premier pas vers la paix.
Et il faut relire le texte de la Amidah du matin: Sim Chalom, tovah ouvrakhah / établis la paix, le bien et la bénédiction, le bien car c'est lui qui nous donne le sentiment du bien-être.
Et plus loin le texte nous espérons que Dieu nous aidera à établir dans notre monde, hèn vahéssèd verahamim vehayim vechalom / la grâce, la douceur, la compassion, la vie car ces éléments mènent à la paix, non la paix intérieure cette fois, mais la paix entre les humains.
Il faut libérer vers l'autre la bonté qui nous habite et que souvent nous cachons ou ignorons. Il faut laisser s'échapper de notre être la douceur et la compassion afin que la vie soit le but ultime de notre existence comme de l'existence de l'autre, but qui est le chemin vers la paix.
Puis le texte continue: Barekhénou ... beor panékha, ki veor panékha natata lano... torat-hayim veahavat héssèd, outzedakah ouverakhah verahamim vehayim vechalom /Bénis-nous en nous accordant la lumière de Ta Face, car cette lumière nous transmet une Torah de vie, c'est-à-dire un enseignement de vie, et l'amour de la bonté, l'entraide, la bénédiction et la compassion, la vie et la paix.
Roch HaChanah 5775 /2014 - 5 -
Le chemin que nous proposent nos Maîtres est d'enseigner la vie, d'aimer la bonté, de favoriser l'entraide, et de rechercher la bénédiction qui s'exprime à travers la compassion envers l'autre, celle qui permet de partager avec l'autre la prise en charge du monde et de son devenir.
Et ce soir nous avons dit: Beséfèr hayim berakhah veshalon nizakhèr venikatèv/ Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le livre de la vie, de la bénédiction et de la paix... lehayim tovim oulechalom / pour une vie bonne et pour la paix.
C'est ainsi que chalom, le dernier mot de chaque phrase de ce texte affirme cette paix comme la conclusion d'un processus d'entrée dans ce monde ci, comme l'aboutissement de l'action humaine, comme un devenir ensemble enfin envisageable et indubitablement atteignable.
La paix n'est plus alors un mot prononcé et sitôt oublié. Elle est l'aboutissement d'un processus qui prend sa source dans la conscience de vivre, dans un sentiment de bien-être et de plénitude qui dépassent l'individu. Elle se poursuit par l'ouverture vers l'autre, vers les autres avec leurs individualités et leurs particularités, les autres qui sont plus qu'un vocable, les autres qui, comme chacun de nous, sont des êtres multiples et uniques à la fois.
Alors vient la conclusion de la bénédiction: Baroukh Atah Adonay, haMélèkh haShalom / Béni sois-Tu Eternel, Roi de la paix.
Ce cheminement peut être le nôtre si nous ne réduisons pas l'autre à une seule qualité, si nous lui accordons la possibilité d'exprimer le potentiel positif qu'il recèle.
Ce cheminement est ardu lorsque l'ennemi se dresse en face. Mais pour atteindre un bien-être collectif où rien de sacré n'existe sinon la vie de chaque individu, il faut redonner à l'autre la qualité de sujet, tout en se plaçant à ses côtés, comme son complément, chacun dans sa complexité, chacun dans sa diversité, chacun dans sa singularité, et composer avec lui et tous les autres, une humanité multicolore.
Puisse-t-il en être ainsi Chanah Tovah
Sermon de Yom Kippour 5775 - Rabbin Jonathan Magonet - Kehilat Kedem, Montpellier
Yom Kippour Sermon, Kehilat Kedem, Montpellier 2014
Jonathan Magonet
Ce sermon a été particulièrement difficile à rédiger. Je suppose que tous mes collègues ont eu le même défi à relever cette année : comment parler de notre expérience en tant que Juifs l’année qui vient de s’écouler, alors que nous avons été accablés par les évènements tragiques qui se sont déroulés au Proche-Orient, et leurs répercussions sur les communautés de la Diaspora. Je ne sais pas plus que quiconque ce qui se passe réellement sur le plan politique. Je suppose que je partage avec vous un mélange de colère et d’anxiété, aussi bien que de frustration, car rien ne semble changer, il semble n’y avoir eu aucune amélioration dans le conflit, et les évènements paraissent hors de notre portée, hors de notre influence. Je suis aussi conscient que la chaire rabbinique ne devrait pas être utilisée comme plateforme politique. Le simple fait d’évoquer ces sujets pourrait en offenser plus d’un, mais éviter d’en parler signifierait n’accepter aucune responsabilité. Je vais essayer de trouver la voie du milieu, au risque d’offenser tout le monde ! Commençons par ce que nous dit la tradition juive.
J’ai entendu une fois le compositeur Danny Maseng parler du chant qui introduit l’office, mah tovou ohalekha ya’akov
Mishkenotekha yisrael.
Comme tes demeures sont belles, Jacob,
Tes lieux de résidence, O Israël !
Il s’est penché sur une vieille question rabbinique, qui porte sur le récit biblique qui évoque le combat de Jacob avec un homme mystérieux au milieu de la nuit. Le nom de Jacob est dérivé de l’hébreu ‘ekev, qui signifie « talon ». Jacob est un homme complexe et rusé, à la fois impulsif et calculateur. Il est allé jusqu’à tromper son père et voler la bénédiction qui devait être accordée à son frère Ésaü. Pour cela, Jacob a été puni par vingt ans d’exil, et il a dû se frotter à un beau-père également rusé et trompeur, Laban. Et maintenant, Jacob est sur le chemin du retour vers sa maison, et son frère Ésaü, à qui il avait volé la bénédiction, l’attend sur le chemin. La nuit qui précède cette rencontre, il lutte avec un mystérieux homme. A la fin de ce combat, Jacob reçoit un nouveau nom, Israël, celui qui lutte avec Dieu, ou celui qui lutte pour, ou au nom de Dieu. Mais une question se pose : s’il a déjà atteint le niveau qui lui permette d’être appelé Israël, pourquoi est-il toujours appelé Jacob dans les récits suivants dans la Bible Hébraïque ? La réponse que donne Danny Maseng reflète un point de vue déjà présent dans la tradition juive. Nous pouvons tous avoir des moments où nous sommes vraiment Israël, lorsque l’âme en nous se lie à Dieu, lorsque nous sommes à la hauteur des plus hautes valeurs qui sont en nous. Mais nous ne pouvons pas toujours maintenir un tel niveau de spiritualité, et nous retombons, et redevenons à nouveau Jacob. Ceci, dit Danny Maseng, est une explication de ce que signifie mah tovou ohalekha, que tes tentes sont belles, O Jacob. La tente n’est qu’une demeure temporaire, vers laquelle nous ne cessons de revenir. Mishkenotekha yisrael, car comme le peuple d’Israël, nous sommes appelés à vivre dans le mishkan, le sanctuaire dans lequel Dieu peut être trouvé. Cette maison est notre vraie maison, ou, au moins, celle à laquelle nous aspirons.
Nous sommes Jacob, et nous sommes Israël ; nous passons d’une identité à l’autre.
Retournons maintenant vers le récit de Jacob luttant avec l’homme au milieu de la nuit. Vingt ans après avoir volé la bénédiction à son frère Ésaü, Jacob retourne à la maison. Et il est effrayé. La dernière chose qu’il a entendue de son frère est que celui-ci le hait et veut le tuer. Pendant vingt ans, la crainte et la culpabilité d’avoir agi ainsi ont eu le temps de grandir. Il envoie alors ses serviteurs au devant de lui vers Ésaü avec des cadeaux. Ce sont en partie des offrandes de paix, ou peut-être des pots-de-vin, mais aussi un moyen de savoir ce qu’Ésaü a réellement l’intention de faire. Il apprend alors qu’Ésaü vient vers lui avec 400 hommes. Est-ce une armée pour le tuer, ou une garde d’honneur pour l’accueillir ? Jacob ne le sait pas, pas plus que le lecteur à ce point de l’histoire.
C’est cette nuit-là qu’il lutta avec l’homme. Dans le Sefer Bereishit, le mot ‘ish est utilisé dans le texte pour décrire ce personnage. Ce n’est que dans le livre d’Osée (12 :4) qu’il est appelé mal’akh, messager, ou ange. Les rabbins pensent qu’il pourrait s’agir de l’ange-gardien d’Ésaü. Il existe un autre moyen de comprendre l’identité de cet « homme ». C’est comme si Jacob luttait avec lui-même, avec ses peurs, avec le monstre horrible qu’Ésaü était devenu dans son imagination pétrie de culpabilité. Ce n’est que lorsque ce combat intérieur a été gagné, après qu’il ait lutté avec ses propres démons, que Jacob pourra faire face au réel Ésaü qui vient à sa rencontre. A la grande surprise de Jacob, Ésaü le prend dans ses bras, l’embrasse, et les deux frères se réconcilient. C’est toutefois une réconciliation prudente. Jacob insiste pour qu’ils gardent leurs camps séparés. Il y a trop d’histoires, de rivalités, et une trop longue méfiance, pour que tout soit mis de côté en une nuit. Les deux frères peuvent bien se retrouver, mais qui sait ce que les membres de leurs camps pourraient bien faire ? Les dispositions sont pratiques et réalistes afin de les tenir à l’écart les uns des autres, mais au moins la relation entre les deux frères a-t-elle été restaurée.
De même que Jacob a deux noms, Ésaü a lui aussi deux noms. A sa naissance, il était couvert de poils roux, adom. Puisqu’il a voulu manger du potage « roux » que Jacob avait cuisiné, et pour lequel il avait vendu son droit d’aînesse, Ésaü reçoit un deuxième nom, « Édom », le « Rouge ». Plus tard, dans l’histoire biblique, les descendants d’Ésaü, les Édomites, deviennent les ennemis d’Israël. Profitant de la conquête babylonienne du royaume de Juda au sud, ils attaquèrent Jérusalem, et participèrent à sa destruction (Ps. 137 :7). La relation entre les deux se maintient cependant, comme le rappelle explicitement le Sefer Devarim : « Tu n’abhorreras pas l’Édomite, car il est ton frère… leurs enfants peuvent entrer dans la congrégation de l’Éternel à la troisième génération » (Deut. 23 :8-9). Comme dans le cas de Jacob, les noms d’Ésaü suggèrent différents personnages. Il peut être Ésaü, le frère qui recherche la réconciliation en dépit du tort causé par Jacob quand il vola sa bénédiction, ou Édom, le violent, qui cherche à tirer vengeance. Lorsque un « Jacob » rencontre un « Édom », la méfiance, le conflit, voire le bain de sang sont possibles, car celui qui est malhonnête rencontre celui qui est violent. Lorsque un « Israël » rencontre un « Ésaü », les deux frères peuvent se réconcilier.
Les conflits intérieurs de Jacob ont eu des conséquences pour notre identité en tant que peuple juif. Mais si nous pouvons être Jacob ou Israël, qui sont les Ésaü ou Édom de notre histoire, particulièrement aujourd’hui ? Cela soulève encore une autre question. Existe-t-il un moyen par lequel Jacob/Israël peut faire d’Édom l’ennemi Ésaü le frère ?
A ce moment de notre histoire, Israël, l’État d’Israël, fait face à un type particulier d’Édom, un Édom qui peut être identifié de trois manières différentes : le peuple palestinien, qui veut son propre État, et le groupe dont la face et la nature ne cesse de changer de ceux qui en son sein ne souhaite rien d’autre que la destruction de l’État d’Israël ; les nations arabes de la région, avec leurs propres difficultés intérieures, politiques, idéologiques, et religieuses, qui s’ajoutent à leur difficulté à admettre l’existence-même d’Israël ; et au-delà, les dimensions multiples et complexes du monde musulman. Ces trois dimensions doivent être prises en compte si l’on recherche la réconciliation et si la paix arrive un jour à être établie.
C’est un programme très chargé, trop large pour un sermon, même en ce long jour de Kippour ! Cependant, nous qui vivons dans la diaspora, nous devons nous demander quelle est notre part de responsabilité dans cette situation. Nous ne sommes pas Israéliens. Nous ne sommes pas à titre personnel prisonniers du conflit militaire qui devient de plus en plus violent. Nous n’avons aucun droit de vote dans le système politique israélien afin d’influencer la politique de son gouvernement. Nous ne sommes pas confrontés quotidiennement à la difficulté de vivre sous une menace constante. Nous souffrons parfois localement des retombées de chaque nouvel épisode du conflit. Mais nous appuyons et soutenons aussi par notre engagement envers Israël l’idée que cet État est le foyer du peuple juif. Nous éprouvons de la tendresse et de l’affection pour de la famille ou des amis qui vivent là-bas. Sur un plan personnel, nous leur apportons notre soutien par nos visites, nos contacts, et l’aide que nous leur offrons, particulièrement en un temps comme le nôtre. Mais peut-on faire plus ?
C’est le deuxième sujet dont je voulais vous parler aujourd’hui, et dont j’éprouve des difficultés à parler. En tant que Juifs de la diaspora, nos relations avec les différentes communautés musulmanes locales, avec lesquelles nous partageons le même statut de minorité, sont de plus en plus importantes. C’est assez difficile pour moi d’en parler, puisque mon expérience au Royaume-Uni est très différente de la vôtre en France, où le niveau de menace, la réalité de la violence, et la peur perceptible dans les rues de vos villes sont bien plus fortes. Cependant, notre distance avec le Moyen Orient nous permet de nouer des contacts que les Israéliens ne peuvent avoir. Nous avons réellement la possibilité de créer des relations avec les Musulmans, sur le plan individuel, ou avec leurs communautés, si nous cherchons à bâtir sur le long terme sans rechercher nécessairement des résultats immédiats. Mais avant de faire cela, nous devons affronter nos propres peurs et préjugés, comme Jacob face à Ésaü. Ce n’est pas chose facile, précisément parce qu’il existe de réelles menaces, et de réelles violences dont nous prenons connaissance chaque jour, et parce que la peur nourrit la peur.
Je veux revenir vers le ‘ish, l’homme qui s’est battu avec Jacob, ou plutôt vers la signification du mot ‘ish lui-même. La Bible Hébraïque le distingue de l’autre nom commun ‘adam, « l’homme ». Ce mot semble être un terme plus général pour désigner l’être humain, la créature formée depuis ‘adamah, « la terre ». Mais un ‘ish est une personne de substance, un individu, quelqu’un qui a une personnalité, une identité, une voix. Ce sens est soutenu par une autre histoire biblique très connue. Un jour, dit le texte d’Exode 2, « Moïse alla vers ses frères, et vit leurs fardeaux ». Que vit-il ? Vayar ‘ish mitzri makeh ‘ish ‘ivri. Traduit littéralement, cela signifie : « il vit un homme, un Égyptien, frapper un homme, un Hébreu ». Les deux protagonistes sont décrits comme des ‘ish, avec ici une précision particulière, leur nationalité, ou leur identité ethnique. Ils ne sont pas des individus, mais des symboles, des stéréotypes du bourreau ou de la victime, chacun piégé dans son rôle. Pourquoi la Bible insiste-t-elle là-dessus ? Car le verset suivant propose une situation alternative : Moïse regarda, vayar ki ein ‘ish, et il vit qu’il n’y avait pas d’homme. La plupart des traductions interprètent cela comme un acte de lâcheté. Il regarda aux alentours et vit que personne ne regardait dans sa direction. Cette interprétation est de toute évidence fausse, car dès le lendemain, tout le monde était au courant. Il existe une meilleure lecture, qui consiste à dire qu’il n’y avait aucun homme qualifié de mitzri ou de ‘ivri, c’est-à-dire, aucun individu à part entière qui aurait voulu ou pu intercéder. Ainsi Moïse, un véritable ‘ish, prit une décision qui déterminera le reste de sa vie. Comme s’il voulait renforcer cette idée, le Livre d’Isaïe reprend la même phrase : « L’Éternel vit, et l’absence de justice lui déplut. Vayar ki ein ‘ish, Il vit qu’il n’y avait pas d’homme, et il fut surpris que personne n’était là pour intervenir ; alors, le bras de Dieu lui apporta la victoire » (Isaïe 59 :15-16). Les rabbins avaient déjà admis cette lecture dans le récit d’Exode 2, mais ils étaient en désaccord quant à son interprétation. Un rabbin affirma qu’il n’y avait, parmi les Égyptiens, aucun « homme » qui acceptait d’abandonner son rôle de bourreau et de s’élever pour la justice. Un autre rabbin estima que les Hébreux étaient tellement accablés par leur statut d’esclaves qu’aucun n’était à même de s’extirper de ce rôle et de résister. Peut-être ce verset est-il la source d’un enseignement attribué à Hillel : Bamakom she’ein anashim hishtadel lihyot ‘ish, « en un lieu où il n’y a aucun homme, efforce-toi d’être un homme » (Avot 2 :6).
Moïse a été capable de s’affranchir des stéréotypes que chaque camp avait de l’autre. Chaque groupe se définissait soit comme victimes, soit comme bourreaux, comme s’ils étaient enfermés pour toujours dans ces identités mortifères. Aucun n’était capable de sortir de cette identification, et de se voir comme un ‘ish, une personne, un être humain aux qualités uniques, avec ses propres valeurs, ses idées, ses besoins, ses attentes, et ses espoirs. Et s’ils étaient incapables de se voir ainsi, il leur était d’autant plus impossible de voir l’autre de cette manière. Devenir ‘ish implique de pouvoir reconnaître notre propre humanité, et par conséquent l’humanité des autres, au-delà des stéréotypes par lesquels nous définissons habituellement l’autre, ou que nous utilisons pour justifier notre ignorance, notre peur, ou notre haine de l’autre. C’est ainsi que les Juifs sont très largement dépeints dans le monde musulman, et c’est précisément ainsi que nous nous représentons les musulmans. Dans les deux cas, la peur et l’ignorance, l’absence de contacts personnels nourrissent les forces qui nous séparent, et au bout du compte empêchent toute possibilité de réconciliation, que sur soit sur un plan local, national, ou international.
Il est assez facile d’analyser de la sorte les sources bibliques et rabbiniques. Mais les appliquer dans les réalités pratiques d’aujourd’hui peut s’avérer très difficile. Cette année marque le 40e anniversaire de la conférence annuelle internationale Juifs, Chrétiens, et Musulmans, dans laquelle j’ai été impliqué depuis les tous débuts. L’objectif initial, qui est toujours le même, était de créer un lieu sûr dans lequel les participants peuvent aller au-delà des stéréotypes et des préjugés que nous avons à propos les uns des autres, et à propos de nos différentes traditions culturelles et religieuses. Dès le début, ce projet nous a paru faire partie de notre devoir religieux, et de nos responsabilités sociales. Durant tout ce temps, la participation à au moins une de ces conférences a été obligatoire pour les étudiants rabbins du Leo Baeck College. Cela signifie que nos étudiants rabbins ont pu se constituer un petit réseau de collègues chrétiens et musulmans, et ils ont souvent encouragé leurs communautés à rencontrer les autres communautés sur le plan local, et même parfois, dans des périodes difficiles, à offrir leur soutien. On a pu assister sur cette période à un développement exponentiel d’initiatives et de projets favorisant le dialogue interreligieux. Toutes ont pu apporter une petite contribution à changer les attitudes et les comportements.
Cependant, la question reste de savoir jusqu’à quel point nous avons réellement changé quoi que ce soit dans le monde. Ceux qui ont des préjugés à l’égard des autres en fonction de leur religion, de leur appartenance ethnique, de leur couleur de peau, ou de leur identité sexuelle, continuent très certainement d’avoir ces mêmes préjugés. Ceux qui sont méfiants à l’égard de la religion en général, y voyant une source de conflits dans le monde, ne sont probablement pas convaincus que le dialogue interreligieux a eu un réel impact sur les doctrines ou les enseignements qu’ils pensent être radicalement opposés aux autres fois, ou aux valeurs humanistes. Et d’un point de vue juif, nous devons inévitablement nous tourner vers le Moyen Orient, particulièrement vers le conflit israélo-palestinien, et nous demander ce qu’un demi-siècle ou plus de dialogue interreligieux, entrepris de manière sérieuse et engagée, a pu avoir comme effet sur ce conflit qui paraît insoluble. Les valeurs religieuses ont pu, à certains moments, aider à changer les attitudes, mais il semble que dans de réels conflits, la religion est prise en otage pour appuyer la politique, plutôt que le contraire.
Et cependant, il y a cette phrase de Rabbi Tarfon qui vient résonne inlassablement à nos oreilles, et nous met au défi : lo alekha ha-melkha ligmor v’lo attah ben chorin l’hibbatel mimmenah, « ce n’est pas à toi de terminer le travail, mais tu n’est pas libre de t’y soustraire » (Avot 2 :21). Quel est alors le travail que nous devons faire dans la diaspora ? Comme Moïse, nous avons l’obligation de rechercher le ‘ish, cet individu qui se tient au-delà des stéréotypes et des préjugés qui définissent notre relation aux autres. Pour certains d’entre nous, cela signifie rencontrer le monde musulman, aussi difficile que ce soit. Nous devons le faire mipney darkey shalom, en vue de la paix, parce que c’est une des étapes essentielles pour aboutir à la paix.
Nous avons commencé par parler du défi intérieur que nous rencontrons tous, le Jacob en nous qui cherche, même de manière brève, à découvrir le Israël qui sommeille en nous. Et aux côtés de ce défi intérieur, il existe aussi un défi extérieur : essayer de se débarrasser des étiquettes qui définissent et limitent notre identité, démanteler les stéréotypes que nous acceptons pour nous-mêmes et projetons sur les autres. Car, à moins de commencer par nous-mêmes, comment pouvons-nous espérer changer les attitudes, les sentiments, et les préjugés des autres ?
Mah tovou ohalekha Ya’akov
Il n’est pas suffisant de rester « Jacob » dans le confort de nos tentes.
Mishkenotekha Yisrael
Au moins une fois par an, à cette époque de l’année, nous devons essayer de devenir « Israël », et d’entrer dans le sanctuaire de Dieu.
La fin de vie - "Y a-t-il un temps pour choisir le repos?" par le rabbin Marc Neiger
Ecrit par Rabbi Marc Neiger
Titre Y a-t-il un temps pour choisir le repos ?
« Il est un temps et un moment pour apprécier chaque chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir » nous dit l’Ecclésiaste (3.1-2). Mais les circonstances ne laissent pas toujours à tous l’opportunité de trouver un temps pour mourir en atteignant la sérénité. Le monde dans lequel nous vivons a brouillé les frontières que connaissaient nos ancêtres et nos sages anciens. La médecine de ces dernières décennies a révolutionné nos vies, nous offrant la possibilité de surmonter certaines des difficultés de l’âge et de vaincre de nombreuses maladies. En nous apportant cette maîtrise de plus en plus importante sur nos vies, et sur notre mort, la médecine moderne nous amène régulièrement à soulever deux questions qui restaient auparavant exceptionnelles :
Existe-t-il un moment où nous avons le droit de refuser la vie ?
Pouvons-nous participer à une telle demande ?
Dans un pays qui a légiféré en légalisant l’euthanasie depuis 10 ans, il devient d’autant plus urgent d’interroger notre tradition. La question n’est pas tant de savoir si des membres de notre communauté feront face à cette possibilité, mais d’être en mesure de parler aux familles qui l'ont déjà rencontrée et à ceux qui y font face aujourd'hui. Sans chercher à apporter une réponse tranchée, je souhaiterais montrer ici que notre tradition est beaucoup moins monolithique que ne le laissent entendre les autorités "traditionnalistes", et que, sans rallier l’autonomie absolue de l’individu prônée par notre société, le Judaïsme nous ouvre quelques portes.
Les décisionnaires les plus stricts dans le monde orthodoxe s’opposent rigoureusement à toute tentative d’abréger la vie. Pour ces possekim, notre corps et notre vie ne nous appartiennent pas, la vie est sacrée quelles que soient les circonstances et la souffrance, la perte de la qualité de vie ou de l’espoir ne sauraient donc autoriser une action destinée à hâter la fin de vie, ni de la part du malade, par le suicide, ni de la part d’un tiers, par l’euthanasie, ni ensemble, par le suicide assisté.
L'interdiction d’agir directement contre sa vie est pourtant contredite dans le Talmud (Guittin 57b) dans une terrible compilation de récits de martyrs (Kiddouch haChem). Cette série de récits inclut, entre autres, le supplice et l’exécution de « la mère et ses sept fils » qui refusent tous de rendre un culte aux idoles. Si la halakha prescrit clairement de se laisser exécuter plutôt que de transgresser l’interdiction de l’idolâtrie, de l’inceste et du meurtre, elle ne prescrit cependant pas le suicide pour l’éviter. La nuance peut paraître aussi futile que morbide, elle est cependant critique concernant notre sujet et l’attitude face à une situation insupportable ou désespérée.[1] Pourtant Guittin 57b nous raconte aussi le martyr d’un groupe de 400 enfants, filles et garçons, destinés à l’esclavage et à la prostitution par les Romains et qui choisissent de se jeter dans la mer pour y échapper et surtout « atteindre la vie du monde futur » : אנו באין לחיי העולם הבא. Par ces termes, le texte indique non seulement que leur attitude est tolérable à cause de circonstances exceptionnelles, mais bien qu’elle est absolument louable, et qu’il existe donc des circonstances, si terribles soient-elles, où nous pouvons porter atteinte à notre propre vie. Ceci ne suffit bien sûr pas pour approuver l’euthanasie, mais cela réfute l’absolu derrière lequel se réfugient les décideurs les plus conservateurs pour ne pas chercher de solution à des situations qui deviennent littéralement invivables pour certains malades et leurs familles.
La médicine est aujourd’hui capable de maintenir quasi-indéfiniment en état de fonctionnement des corps dont nous savons qu’ils ne sont plus vivants, ce qui est défini aujourd’hui par la mort cérébrale. Mais dans d’autres situations la médicine est aussi consciente de son impuissance, et elle prédit avec certitude et résignation les prochaines étapes de la maladie et la durée du scénario vers l’issue fatale. C’est le cas lorsque la maladie atteint le stade dit terminal ; en fonction des pathologies, cette phase terminale peut-être courte, mais elle peut aussi s’annoncer longue avec un cortège de souffrances et de dégradations.
Partant de connaissances et de moyens infiniment plus limités, notre tradition traite la situation de manière plus simpliste, presque naïve au vu de notre médicine, mais avec le sérieux absolu qui sied à la vie humaine. Le Talmud envisage deux catégories, le « gossès » גוסס et le « teréfah » טריפה. Le gossès est un mourant sur son lit de mort dont nous savons qu’il expirera dans les trois jours. Les textes insistent pour nous dire que le gossès doit être considéré avec le plus grand respect et comme n’importe quel autre être humain et qu’il est donc interdit de hâter son décès ou de commencer à préparer ses funérailles.
הגוסס הרי הוא כחי לכל דבר לעולם
Le gossès (mourant) est comme un vivant en toute matière. (Evel Rabbati 1.1).
Tant pour les orthodoxes que pour la majorité des progressistes, la plupart des réflexions concernant la fin de vie ont considéré le malade comme un gossès, en particulier parce que cela a été l’approche de Maïmonide. Mais le Talmud nous présente en opposition le teréfah,[2] celui dont un organe vital est atteint, par une blessure ou une pathologie (Sanhédrin 78a). Son décès est certain à cause d’une lésion, mais pas forcément immédiat, son espérance de vie pourrait même atteindre douze mois selon certains. Le teréfah est lui considéré comme « déjà mort », s’il disparaissait son épouse serait déclarée veuve après douze mois. Plus surprenant encore, Rava[3], un amora[4] très important du début de 4ème siècle, affirme que celui qui tue un teréfah n’est pas h’ayav, assujetti à un châtiment en tant que meurtrier (Sanhedrin 78b), en d’autres termes le sang du teréfah est "moins rouge".[5]
Si pour nos ancêtres la distinction entre gossès et teréfah était peut-être simple, elle est beaucoup plus difficile à faire aujourd’hui. Pour les rabbins de l’antiquité et du moyen-âge, le gossès était un mourant sur son lit de mort et proche d’une mort naturelle, alors que le teréfah était mortellement blessé, ou atteint par une lésion interne et fatale. A l’heure où j’écris ces lignes, Ariel Sharon est toujours vivant, mais il est dans un coma irréversible depuis plus de 8 ans et les médecins annoncent que son état a empiré suite à une défaillance rénale. Ariel Sharon était-il déjà gossès ou teréfah avant cette dégradation, alors qu’il n’existait déjà plus d’espoir de rétablissement, ou l’est-il devenu parce que la médecine n’est peut-être plus capable de maintenir ses fonctions vitales indéfiniment ? Strictement parlant, aucune des définitions ne convient : les délais de référence, trois jours et douze mois, sont inadaptés. Quelle est la définition aujourd’hui d’une mort naturelle par opposition à la mort résultant d’une lésion ou d'une pathologie spécifique ? Des maladies fatales, invisibles pour nos ancêtres, sont devenues des évidences pathologiques pour nos moyens d’exploration, par les analyses ou l’imagerie médicale.
La famille d’Ariel Sharon envisage aujourd’hui de débrancher ses systèmes de survie, et de le laisser partir, ce que certains appellent l’euthanasie passive parce qu’il n’y a pas d’action qui accélère directement la venue de la mort. Beaucoup de rabbins progressistes, et même quelques orthodoxes, jugent cette possibilité acceptable, en se basant sur le récit de la mort de Rabbi, Judah haNassi, que l’on trouve dans Ketoubot 104a.
ההוא יומא דנח נפשיה דרבי, גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי ... סליקא אמתיה דרבי לאיגרא, אמרה: עליוני׳ מבקשין את רבי והתחתוני׳ מבקשין את רבי, יהי רצון שיכופו תחתונים את העליונים. כיון דחזאי כמה זימני דעייל לבית הכסא, וחלץ תפילין ומנח להו וקמצטער, אמרה: יהי רצון שיכופו עליונים את התחתונים. ולא הוו שתקי רבנן מלמיבעי רחמי, שקלה כוזא שדייא מאיגרא [לארעא], אישתיקו מרחמי ונח נפשיה דרבי.
Le jour où l’âme de Rabbi fut mise au repos, les rabbins décrétèrent un jeûne et prièrent pour la miséricorde [divine]. … La servante[6] de Rabbi monta sur le toit et dit : les êtres d’en haut (les anges) réclament Rabbi, et les êtres d’en bas (humains) réclament Rabbi. Que ce soit la volonté (divine) que les humains fassent plier les anges. Quand elle vit comment il (Rabbi) montait souvent au trône (aux toilettes), et comment il souffrait en enlevant et remettant ses téfilin (à chaque fois), elle dit : que ce soit la volonté divine que les anges fassent plier les humains. Alors que les rabbins ne cessaient pas d’invoquer la miséricorde (divine), elle prit une cruche et la jeta du toit par terre. Cela leur fit taire [l’invocation] de la miséricorde et l’âme de Rabbi fut mise au repos.
Bien que l’histoire de la mort de Rabbi puisse être lue et interprétée de différentes manières, elle est une des rares aggadah à aborder directement notre question. Elle affirme la possibilité d’agir d’une manière qui puisse entraîner la mort du malade, et elle confère même cette possibilité à un proche du malade lui-même. La majorité des discussions autour de la mort de Rabbi concerne la nature de l’action de la servante. Pour la plupart des décisionnaires, y compris le Choulhan Aroukh (Yoré Deah 339.1), il est possible de suspendre une action qui retarde la mort. Mais certains penseurs progressistes perçoivent de manière plus floue la différence entre le « laisser mourir » et le « aider à mourir ».
En effet, si l’on peut laisser mourir par l’absence d’action, ce qui prend le plus souvent la forme du refus d’acharnement thérapeutique et passe parfois par l’arrêt des systèmes qui maintiennent la vie, la question qui apparaît rapidement est de savoir si l’on peut suspendre la nutrition et l’hydratation du malade. Pour la majorité des rabbins,[7] la réponse est négative mais dans de nombreux pays, le système légal a laissé là une porte entrouverte. Le dilemme imposé est alors la dichotomie entre les possibilités légales et les valeurs éthiques, celles du Judaïsme en particulier, à laquelle s’ajoutent la frustration d’une mort lente et une hypocrisie affichée quant à la nature même de la procédure.[8] Existe-t-il vraiment une différence morale entre retirer le tube de l’alimentation parentérale (euthanasie passive ?) et l’injection d’une surdose de morphine (euthanasie active ?) ? Tant concernant l’acte lui-même que la prise de décision qui le précède ?
Il serait également indigne de limiter la question d’une mort planifiée à une argutie technique sur ce qui est permis ou ne l’est pas. Le contexte humain doit demeurer central dans l’évaluation de telles questions. Un souci majeur de la législation Belge est de s’assurer du caractère insupportable et irréversible de la situation, mais aussi de la volonté éclairée et déterminée du malade, ainsi que de ce sa capacité à prendre une décision sans être sous l’influence d’un sentiment dépressif. Mais il est impossible de proposer une procédure infaillible pour évaluer ce qui est purement subjectif.
Là aussi l’histoire de Rabbi Judah haNassi et de sa servante nous apporte une suggestion car Rabbi n’intervient pas dans la prise de décision. C’est sa servante qui prend la décision de rendre l’âme de Rabbi au ciel, alors que ses disciples, les rabbins, s’y opposent avec acharnement. Bien que la servante demeure anonyme, la complicité entre Rabbi et sa servante est réelle, et c’est elle qui est dépositaire de son enseignement de la compassion comme le raconte le Talmud (Baba Metzia 85b). Il est également évident que la servante de Rabbi ne bénéficiera pas de son décès, au contraire. Comme Job, Rabbi accepte sa souffrance et les effets dégradants de sa maladie à peine voilés par le texte.
De la même manière que la famille ne parvient parfois pas à se résoudre à laisser partir un proche, à l’image des disciples de Rabbi, il convient de se méfier de ce que nous appelons compassion lorsque nous en parlons pour justifier une fin de vie. Qui sert-on vraiment lorsque nous admettons l’idée que nous pourrions achever une vie par compassion ? Est-ce vraiment le mourant que nous envisageons de soulager, ou est-ce notre incapacité à supporter la souffrance de l’autre parce qu’elle nous met en face de nos propre peurs ? C’est d’autant plus difficile à déterminer lorsque le mourant est déjà inconscient ou devenu clairement incapable de s’exprimer.
Dans le cas où le mourant conserverait ses capacités de communication et de réflexion, une approche éthique et juive nécessite plus de précautions que la loi ne peut en imposer. Le critère qui permet d’autoriser la procédure ne peut dépendre de considérations utilitaristes ou économiques. Il ne peut être déterminé uniquement par le malade ou par ses proches. Un « tiers de confiance », familier mais indépendant, devrait pouvoir intervenir dans le processus ; c’est ici le rôle de la servante de Rabbi. La tradition nous dit que Rabbi était familier de la souffrance et de la maladie (Baba Métzia 85a), mais la servante constate un changement radical pendant l'agonie de Rabbi. Non seulement cette souffrance devient plus intense, mais celle-ci devient liée au port des téfilin et à la nécessité de les enlever puis de les remettre à chaque fois que Rabbi se rend "au trône". Cette souffrance liée aux téfilin est contradictoire avec l'idéal de vie Rabbi Judah haNassi. Même si les catégories de gossès et de teréfah ne conviennent pas non plus à Rabbi, sa servante prend la décision radicale parce qu'elle perçoit dans la situation de Rabbi la limite de sa dignité et la disparition de l'étincelle de l'image du divin, צלם אלחים : en devenant un calvaire le port des téfilin perd son sens et remet en cause la dignité de Rabbi.
La détermination de ce qui constitue l'image du divin dans un être humain, et de sa disparition, ne peut être définie de manière objective et générale. Chaque vie humaine contient un aspect différent de l'image divine et la perte de cette étincelle dépendra pour chacun de ce qu'il est et de son histoire personnelle ; c'est ce que le rabbin Peter Knobel appelle notre aggadah personnelle. Si un cadre de réflexion peut-être posé, aucune conclusion générale n’est possible et la décision doit être partagée par les personnes impliquées, malades et proches, mais aussi par des tiers de confiances comme les médecins, psychologues, et pour un Juif le rabbin de sa communauté. Il ne peut y avoir d’autorisation à priori pour supprimer une vie, mais seulement, lorsqu’il n’est plus possible de « choisir la vie », d’aider à partir dignement et à trouver « un temps pour mourir ».
Bibliographie additionnelle
Knobel, Peter. “Suicide, Assisted Suicide, Active Euthanasia, an Halakhic Inquiry — Beth Shalom.” 2011. http://www.bethshalom.org.nz/suicide-assisted-suicide-active-euthanasia-an-halakhic-inquiry/.
UAHC Comitee Bio-Ethics. Voluntary Active Euthanasia - Assisted Suicide. Bio-Ethics Case VI. 1993. http://huc.edu/kalsman/docs/11/may/Voluntary%20Active%20Euthanasia-Assisted%20Suicide%20-%20Bioethics.pdf.
[1] Dans l’histoire de Massada telle qu’elle nous est rapportée par Flavius Josèphe, seul le dernier perdant du tirage au sort se suicide effectivement, les autres sont tués par leurs compagnons.
[2] Plus récemment R. Elliott Dorff, Dr Daniel Sinclair, et R. David Knobel ont étudié l’approche du teréfah.
[3] Rava, רבא : Surnom de Rav Abba ben Joseph bar Hama, ~280-352 EC. Il fut l'un des sages les plus important du Talmud de Babylone et le principal contradicteur de Abbaye.
[4] Amora : rabbin du Talmud actif entre la cloture de la Michnah (220 EC) et la fin du 5ème siècle (500EC).
[5] Sinclair pose même la question de savoir si l’euthanasie du teréfah pourrait avoir lieu au nom de pikouah’ nefèch dans le cas où un des organes pourrait être transplanté et sauver une vie. Knobel, Peter. “Suicide, Assisted Suicide, Active Euthanasia, an Halakhic Inquiry — Beth Shalom.” In Death and Euthanasia in Jewish Law: Essays and Responsa, edited by Walter Jacob and Moshe Zemer. Rodef Shalom Press. Accessed June 29, 2013. http://www.bethshalom.org.nz/suicide-assisted-suicide-active-euthanasia-an-halakhic-inquiry/.
[6] La servante de Rabbi est un personnage reconnu pour son savoir et sa sagacité.
[7] Dorff, Elliot. “Assisted Suicide.” Dans Responsa of the CJLS 1991-2000, 379–397. Rabbinical Assembly. http://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/public/halakhah/teshuvot/19912000/dorff_suicide.pdf.
[8] CCAR. “On the Treatment of the Terminally Ill 1994 5754.14.” http://ccarnet.org/responsa/tfn-no-5754-14-337-364/.
Le mariage juif, Rabbin David Goldberg, LJS, London - Traduit par Carole Grousset
Le mariage juif
Le mariage a toujours été hautement valorisé dans la tradition juive. Se marier était considéré comme une obligation et le célibat, pratiqué par des sectes minoritaires telles que les Esséniens, n'a jamais été favorisé par le courant principal du judaïsme. Les prêtres de l'ancien temps étaient habituellement mariés comme les rabbins qui leur ont succédé dans leur ministère auprès du peuple.
Pour le judaïsme, le mariage sert trois buts étroitement liés. D'abord, la propagation de l'espèce humaine, ainsi qu'elle est ordonnée dans la Genèse 1.28. "Soyez fertiles et multipliez-vous". Selon la loi talmudique, cette obligation est considérée comme avoir été remplie quand un homme a engendré au moins un fils et une fille comme Dieu a créé un homme et une femme dans le jardin d'Eden.
Deuxièmement, le mariage permet l'amour des partenaires. De nouveau, dans les termes du livre de la Genèse, "Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. C'est pourquoi un homme devra quitter son père et sa mère et se fondre avec sa femme et ils deviendront une seule chair" (Genèse 2-18 et 24). Idéalement, le mariage est une relation qui dure toute la vie, fait de fidélité, de respect et d'attention mutuels. Certainement, dans les sources traditionnelles qui reflètent la société ancienne et patriarcale, le mariage est vu en premier lieu dans une perspective masculine mais il est notable qu'une grande insistance est mise sur les droits, économiques, sociaux et sexuels de la femme. Un enseignement rabbinique typique loue l'homme "qui aime sa femme comme lui-même et l'honore plus même que lui même" (Yebamot 62b).
Troisièmement, le mariage établit la famille comme une unité sociale de base et le foyer comme le (miqdach me’at) "petit sanctuaire" (Ezekiel 11 : 16) dans lequel le père correspond à un cohen, la mère à une cohenet et la table à un autel. C'est là où les enfants peuvent grandir sous la protection et l'accompagnement de leurs parents dans l'amour et le lieu où la religion juive peut être pratiquée et transmise de génération en génération.
C'est généralement la philosophie du mariage juif. Nous pourrions aussi noter que l’idée d’un amour romantique - un concept européen médiéval – n’a joué que peu de rôle dans les mariages juifs ou autres qui étaient arrangés autrefois par les parents. De nos jours, dans presque toutes les communautés juives, les jeunes gens choisissent leurs conjoints. La loi juive ne permet à quiconque d'être marié contre sa volonté. Même ainsi, dans certains cas, leur choix fait l'objet d'un certain nombre de restrictions.
Il pourrait sembler superflu de commencer par mentionner que le mariage juif est monogame mais cela n'a pas été toujours le cas. La polygamie masculine (mais non féminine) était permise aux temps bibliques et talmudiques bien qu'elle fût de plus en plus rarement pratiquée. C'est seulement à la fin du douzième siècle qu'elle fut formellement interdite parmi les juifs Ashkénazes bien qu'elle soit encore théoriquement autorisée, là où la loi du pays le permet, parmi les juifs Sépharades.
Une restriction plus pertinente est que un mariage juif est seulement possible là où les deux parties sont juives. L'opposition juive aux mariages mixtes a pour origine la crainte que les influences païennes ne dévoient la vie religieuse de la nation. Elle vient aujourd'hui de l'inquiétude par rapport aux conséquences démographiques pour la survie du peuple juif si les mariages mixtes devaient à un niveau élevé - entre 25 et 50 pour cent - chiffre qu'il a atteint en Amérique et dans certains pays européens, y compris la Grande Bretagne. Si ça ressemble à un argument contre le mariage en dehors de la communauté juive, un argument plus positif que les études statistiques semblent confirmer, est que les chances d'un couple de cimenter un mariage stable sont renforcées par un socle de visions partagées, d'aspirations et de valeurs religieuses.
Quand l'un des partenaires n'est pas juif, lui ou elle peut, bien sûr se convertir au judaïsme et ensuite se marier avec une cérémonie religieuse. Il faut noter que les conversions réalisées dans les synagogues progressives ne sont pas reconnues par les autorités traditionnalistes.
Une troisième restriction est constituée par les unions interdites basées sur des liens de consanguinité tels qu’élaborés dans la Bible (principalement Lévitique 18) et développées plus tard dans la loi rabbinique. Ces unions interdites sont en général en accord avec celles prohibées par la législation civile de la plupart des pays mais deux particularités doivent être mentionnées. La première concerne un mari qui disparaît sans laisser de trace, par exemple en mer ou pendant une guerre. Alors que les autorités civiles peuvent déclarer que la veuve putative est libre de se remarier, la loi juive traditionnelle ne lui permettrait de le faire sans ce qu'elle considère comme une preuve indubitable de sa mort.
D'autres complications peuvent surgir dans les cas de divorce. La tradition juive prône le mariage mais reconnaît qu'une rupture de la relation peut se produire, pour une grande variété de raisons et permet ainsi le divorce. Dans le judaïsme orthodoxe, la procédure religieuse pour le divorce, basée sur le Deutéronome 24 1-4, peut seulement être initiée par le mari et après l'acceptation d'une dissolution civile du mariage. Si, pour quelque raison que ce soit, un couple juif qui a obtenu un divorce civil, était incapable ou ne voulait pas procéder à un divorce religieux appelé en hébreu un get, alors, selon la loi traditionnelle, la femme serait encore attachée à son ancien mari et si elle devait se remarier dans de telles circonstances, son second mariage serait techniquement adultère parce qu'il serait en contradiction avec les unions interdites. C'est pourquoi tous les enfants issus de cette union sont considérés comme des mamzerim - , ou « enfants illégitimes », car ils sont le fruit d'une union prohibée et n’ont pas, à leur tour, le droit de se marier avec un autre juif en dehors d’un mamzer. Le judaïsme libéral ne tient pas compte de la loi et des incapacités du mamzer, statut considéré comme injuste sur le plan de l’éthique. Nous permettons à un homme ou à une femme de se remarier à la synagogue. sans divorce religieux préalable[1]. Cependant pour leur propre sauvegarde, nous leur recommandons d'obtenir le get et nous les mettons en rapport avec les autorités orthodoxes concernées.
De façon similaire, le judaïsme traditionnel ne permet pas le mariage religieux d'une divorcée à un Cohen - c'est-à-dire à quelqu'un qui porte le nom de l'ancienne caste de prêtres. Le judaïsme libéral ne reconnaît plus la prêtrise héréditaire et permet qu'un tel mariage soit célébré dans une synagogue.
On peut voir que le judaïsme libéral adopte généralement une attitude plus éclairée pour la question du mariage et du divorce religieux[2].
Comme cela paraît évident, d'après les obligations et les attentes qui entourent le mariage, le judaïsme considère celui-ci comme une entreprise sérieuse, à ne pas prendre à la légère. Le mariage juif idéal pourrait être décrit comme un triangle avec deux êtres humains à sa base et leur Créateur au sommet. Dans un mariage juif, les partenaires sont complémentaires et s'accomplissent eux-mêmes, leur union étant bénie et sanctifiée par Dieu. Dans un engagement solennel, demandant de la patience, du tact et de l'amour, parfois responsable, comme toutes les relations humaines de la colère, la déception et la souffrance. Mais, dans le meilleur des cas, il offre le potentiel d'un bonheur en accord avec les bénédictions de la cérémonie du mariage, bonheur que Adam et Eve ont expérimenté dans le Jardin d'Eden.
Pour de plus amples informations, voir aussi "Guide to Jewish Marriage (Guide du mariage juif) du Rabbin John D. Rayner publié par le Judaïsme Libéral.